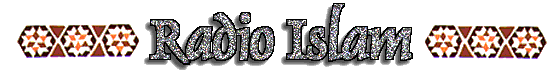
Mon Combat
ADOLF HITLER
7
La Révolution
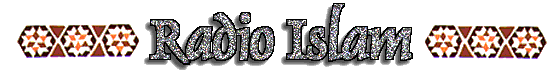
Mon Combat
ADOLF HITLER
7
La Révolution
La propagande ennemie débuta chez nous avec l'année 1915. Depuis 1916, elle alla toujours en s'intensifiant et finit par s'enfler, au commencement de 1918, en un véritable flot. Alors on put déjà suivre pas à pas les effets de cette chasse aux esprits. L'armée apprenait peu à peu à penser comme le voulait l'ennemi.Toute réaction allemande fit entièrement défaut.
L'armée avait, à la vérité, en la personne de son chef intelligent et plein de volonté, l'intention, et la résolution d'accepter le combat également sur ce terrain, mais il lui manquait l'instrument qui aurait été nécessaire à cet effet. De plus, il y avait une erreur de psychologie à laisser entreprendre ce genre de culture intellectuelle par la troupe elle-même. Il fallait, pour qu'elle pût être efficace, qu'elle vînt de l'intérieur du pays. Alors on aurait pu escompter son succès auprès d'hommes de renoncement et d'héroïsme immortels depuis bientôt quatre ans.
Mais qu'advint-il du pays ?
Cette défaillance était-elle stupide ou criminelle ?
Au milieu de l'été 1918, après l'évacuation de la rive sud de la Marne, la presse allemande se comporta d'une façon si misérablement maladroite, ou criminellement stupide, que je me posais une question qui suscitait chaque jour en moi une rage croissante : n'y aurait-il personne pour mettre fin à ce débauchage spirituel des héros de notre armée ?
Que se produisit-il en France lorsqu'en 14 nous fîmes irruption dans ce pays dans un élan inouï et victorieux ? Que fit l'Italie dans les jours de l'effondrement de son front de l'Isonzo ? Que fit de nouveau la France au printemps 1918, lorsque l'attaque des divisions allemandes paraissait chasser
188 de leurs gonds les positions françaises et que le bras puissant des batteries lourdes à longue portée commença à frapper aux portes de Paris ?
Comme on y a toujours fouetté le visage des régiments battant hâtivement en retraite vers l'arrière, comme on y a insufflé l'ardeur des passions nationales ! Comme la propagande et la science géniale d'influencer les masses travaillaient alors pour faire entrer de nouveau à coups de massue dans le cœur des soldats la croyance en la victoire définitive ! '
Plus d'une fois j'ai été tourmenté par la pensée que si la Providence m'avait mis à la place des impuissants ou des gens sans volonté de notre service de propagande, le sort de la lutte se serait annoncé autrement.
Ces mois-là je ressentis pour la première fois la perfidie de la fatalité, qui me maintenait ici et à une place à laquelle le geste fortuit de n'importe quel nègre pouvait m'abattre d'un coup de fusil, alors qu'à une autre place, j'aurais pu rendre d'autres services à la patrie.
Car j'étais déjà alors assez présomptueux pour croire qu'en cela j'aurais réussi.
Mais j'étais un être obscur, un simple matricule parmi huit millions d'hommes !
Donc il valait mieux me taire et remplir aussi bien que possible mon devoir à mon poste.
* En été 1915, les premières brochures ennemies nous tombèrent dans Ies mains. Leur contenu était toujours le même, encore que comportant quelque variété dans la forme de l'exposé, et notamment : que la disette était toujours croissante en Allemagne ; que la durée de la guerre n'aurait pas de fin, cependant que la perspective de la gagner allait constamment en s'évanouissant ; que, pour cette raison, le peuple désirait ardemment à l'intérieur la paix, mais que le « militarisme » ainsi que le « Kaiser » ne le permettaient pas ; que le monde entier - qui savait parfaitement tout cela faisait pour ce motif la guerre non pas contre le peuple allemand, mais au contraire exclusivement contre l'unique coupable, le Kaiser ; que le combat ne prendrait pas fin, pour cette raison, tant que cet ennemi de l'humanité pacifique ne serait pas éloigné ; que les nations libérales et démocratiques
189 recevraient après la fin de la guerre le peuple allemand dans la ligue de la paix perpétuelle mondiale, paix qui serait assurée du jour où serait anéanti le « militarisme prussien ».
Pour mieux illustrer cet exposé, la brochure contenait souvent des copies de « lettres du pays » dont le contenu paraissait confirmer ces assertions.
En général, on se moquait alors de toutes ces tentatives. On lisait les brochures, puis on les envoyait vers I'arrière aux états-majors supérieurs, puis on les oubliait pour la plupart jusqu'à ce que le vent en apportât un nouveau chargement vers les tranchées ; c'étaient, en effet, dans la plupart des cas des avions qui servaient à apporter chez nous ces feuilles.
Une chose devait bientôt surprendre dans ce genre de propagande, à savoir que dans tout secteur du front dans lequel se trouvaient des Bavarois, on attaquait la Prusse avec un extraordinaire esprit de suite, en assurant que non seulement, d'une part, la Prusse était le véritable coupable et responsable de la guerre, mais aussi d'autre part que l'on ri avait contre la Bavière en particulier pas la moindre inimitié ; mais qu'à la vérité, on ne pouvait lui apporter aucune aide tant qu'elle resterait au service du militarisme prussien pour lui tirer les marrons du feu.
Le procédé consistant à influencer les hommes commença réellement, en 1915, à obtenir certains efFets. L'excitation contre la Prusse grandit parmi la troupe d'une façon visible, sans que du haut en bas on ait pris une mesure quelconque pour s'y opposer. Ceci déjà était plus qu'une simple faute, qu'un simple laissez-aller, qui devait tôt ou tard être puni de la façon la plus funeste et atteindre non seulement le « Prussien », mais tout le peuple allemand, la Bavière appartenant bien à ce dernier.
Dans ce sens, la propagande ennemie commença dès l'année 1916 à récolter d'incontestables succès.
De même les lettres de lamentations directement reçues de l'intérieur exercèrent à la longue leur effet. Maintenant il n'était plus aucunement nécessaire que l'ennemi les fît parvenir au front spécialement au moyen de brochures, etc. Et contre ceci on ne fit rien, à l'exception de quelques « admonestations » archibêtes de la part du gouvernement. Le front fut, avant comme après, submergé de ce poison, que des femmes étourdies fabriquaient dans le pays naturellement, sans se douter que c'était le moyen de réconforter au
190 plus haut point la confiance de l'ennemi en la victoire, et de prolonger ainsi que d'augmenter les .souffrances des leurs sur le front. Les lettres insensées des femmes allemandes coûtèrent par la suite la vie à des centaines de milliers d'hommes.
Ainsi se manifestaient déjà, en 1916, divers phénomènes inquiétants. Le front grondait et « faisait la brute » ; il était déjà mécontent pour divers motifs et parfois s'indignait à bon escient. Pendant que les hommes jeûnaient et se résignaient, les leurs étaient en détresse à la maison, tandis qu'en d'autres endroits régnaient le superflu et la dissipation. Oui, même sur le front, tout n'était pas dans l'ordre à ce point de vue.
Aussi la crise se montrait-elle un peu déjà alors ; mais ce n'étaient toujours que les affaires « intérieures ». Le même homme qui d'abord avait grogné et murmuré, faisait, quelques minutes après, silencieusement son devoir, comme si c'était devenu tout naturel. La même compagnie qui d'abord était mécontente, se cramponnait au secteur qu'elle avait à défendre, comme si le sort de l'Allemagne dépendait de ces quelques centaines de mètres de trous dans la boue. C'était encore le front de la vieille, de la superbe armée de héros.
Je devais apprendre à connaître la différence entre le front et le pays à l'occasion d'un changement brutal de ma destinée.
A la fin de septembre 1916, ma division partit pour la bataille de la Somme. C'était pour nous la première des effrayantes batailles de matériel, et l'impression était difficile à décrire - plutôt un enfer qu'une bataille.
Pendant des semaines sous la bourrasque des feux roulants, le front allemand tint ferme, parfois quelque peu refoulé, puis avançant de nouveau, mais ne cédant jamais. Le 7 octobre, je fus blessé.
Je parvins heureusement à l'arrière et pris le train sanitaire vers l'Allemagne.
Deux ans s'étaient écoulés depuis que je n'avais revu la patrie, un laps de temps presque interminable dans de pareilles conditions. Je pouvais à peine me représenter quel était l'aspect des Allemands ne portant pas l'uniforme. Quand je fus couché à l'hôpital d'évacuation, je tressaillis presque d'épouvante quand j'entendis la voix d'une infirmière qui parlait à un camarade couché 'â côté de moi.
191 Après deux ans, entendre pour la première fois la voix d'une Allemande !
Ensuite, plus le train qui devait nous ramener au pays approchait de la frontière, plus chacun de nous sentait une inquiétude intérieure. Toutes les localités défilèrent, dans lesquelles nous avions passé il y a deux ans, comme jeunes soldats : Bruxelles, Louvain, Liège, et enfin il nous sembla reconnaître la première maison allemande à son pignon élevé et à ses jolies persiennes.
La patrie !
En octobre 1914, nous brûlions d'un tumultueux enthousiasme, quand nous passâmes la frontière, maintenant régnaient le silence et l'émotion. Chacun était heureux que le sort lui permît de voir encore une fois ce qu'il devait protéger si difficilement au prix de sa vie ; et chacun de nous avait presque honte de se laisser regarder dans les yeux par les autres.
Presque à l'anniversaire de mon départ pour le front, je me trouvai à l'hôpital de Beelitz près de Berlin.
Quel changement ! Des marais de la bataille de la Somme, j'arrivais dans les lits blancs de ce magnifique bâtiment ! Au début on osait à peine s'y coucher comme il faut. Ce n'est que peu à peu que l'on put se réhabituer à ce monde nouveau.
Mais, malheureusement, ce monde était aussi nouveau sous un autre rapport.
L'esprit de l'armée sur le front ne paraissait plus ici avoir droit de cité. J'entendis ici pour la première fois ce qui était encore inconnu sur Ie front : l'éloge de sa propre lâcheté ! Car ce que l'on pouvait entendre : grogner ou « faire la brute », ce n'était jamais une incitation à manquer à son devoir ou même la glorification du poltron. Non. Le lâche était toujours considéré comme un lâche et absolument rien de plus ; et le mépris qui l'atteignait était toujours général, de même que l'admiration que l'on témoignait à un vrai héros. Mais ici, à l'hôpital, c'était déjà presque l'inverse : les provocateurs les plus insensés disaient de grands mots et s'efforçaient par tous les moyens de leur piteuse éloquence de présenter comme ridicules les principes des bons soldats, et comme modèle, la faiblesse de caractère des poltrons.
Quelques misérables individus donnaient le ton.
L'un d'eux se vantait d'avoir traîné sa main dans un réseau de fil de fer pour pouvoir entrer à l'hôpital ; il semblait
192 cependant que, malgré l'insignifiance ridicule de cette blessure, il était là depuis un temps infini. Et il n'avait été envoyé en Allemagne par train sanitaire que par simple supercherie. Mais ce drôle, semant la contagion, faisait si bien qu'avec son insolente audace, il présentait son acte de lâcheté comme la manifestation d'un courage supérieur à celui du brave soldat trouvant une mort héroïque. Beaucoup écoutaient en silence, d'autres s'en allaient, mais quelques uns aussi approuvaient.
La nausée me montait à la gorge, mais on tolérait tranquillement le provocateur dans l'établissement. Que fallait-il faire ? Ce qu'il était, l'administration devait bien le savoir ! Néanmoins, on ne fit rien.
Quand je pus de nouveau marcher sans difficulté, j'obtins l'autorisation d'aller à Berlin.
La disette était visiblement partout très rude. La ville immense souffrait de la faim. Ix mécontentement était grand. Dans les divers foyers fréquentés par les soldats, le ton était le même qu'à l'hôpital. On avait entièrement l'impression que ces drôles fréquentaient à dessein de pareils lieux, pour propager largement leurs opinions.
Encore pire, bien pire, était la situation à Munich même!
Lorsqu'après guérison je quittai l'hôpital et fus affecté su bataillon de dépôt, je crus bien ne plus reconnaître la ville. L'irritation, le découragement, les invectives, jusqu'où en était-on venu i Dans le bataillon de dépôt même, le moral était au-dessous de tout. A cela contribuait encore la façon infiniment maladroite dont les soldats venant du front étaient traités par les médiocres officiers instructeurs, qui n'avaient encore point passé seulement une heure sur le front et déjà, pour ce motif, ne pouvaient guère organiser un ordre de choses convenant aux vieux soldats. Ces derniers possédaient, en effet, certaines singularités qui s'expliquaient par le fait qu'ils avaient servi sur le front, mais restaient entièrement incompréhensibles pour le commandement de ces formations de troupes de remplacement, tandis qu'un officier venant également du front aurait su, pour le moins, se les expliquer. Ce dernier lui-même était naturellement autrement considéré par les hommes de troupe que le commandant d'étapes. Mais, à part tout cela, l'état d'esprit générai était lamentable ; tirer la carotte était considéré
193 comme la manifestation d'une intelligence supérieure, tandis que la fidèle persévérance était interprétée comme le signe d'une faiblesse intérieure et d'un esprit borné. Les bureaux étaient bondés de Juifs. Presque tous les secrétaires étaient Juifs, et tout Juif, secrétaire. Je m'étonnais de cette abondance d'embusqués du peuple élu et ne pouvais faire autrement que de comparer leur nombre à celui de leurs rares représentants sur le front.
La situation était encore plus mauvaise au point de vue économique. Le peuple juif était réellement devenu « indispensable ». L'araignée commençait à sucer doucement le sang du peuple allemand.
Par le biais des sociétés de guerre, on avait trouvé l'instrument voulu pour donner le coup de grâce à l'économie nationale et libre.
On affirmait la nécessité d'une centralisation sans limites. De la sorte, dès l'hiver 1916-1917, presque la totalité de la production se trouvait en réalité sous le contrôle de la finance juive.
Et contre qui se portait la haine du peuple ?
A ce moment, je vis avec épouvante l'imminence d'une fatalité qui, si elle n'était pas détournée à l'heure propice, devait conduire à la débâcle.
Pendant que le Juif pelait la totalité de la nation et la pressurait sous sa domination, on excitait les gens contre a les Prussiens ». Bien connue sur le front, cette propagande ne trouva aucune réaction à l'arrière. On ne paraissait nullement se rendre compte que l'effondrement de la Prusse serait bien loin d'entraîner un essor quelconque de la Bavière, et que, bien au contraire, l'une par sa chute devait irrémédiablement entraîner l'autre dans l'abîme.
Ces agissements m'affligeaient infiniment. En eux, je ne pouvais voir que la géniale astuce du Juif, qui détournait de lui l'attention générale pour la porter sur d'autres buts. Pendant que la Bavière et la Prusse se disputaient, il leur subtilisait devant le nez leurs moyens d'existence ; pendant que l'on invectivait en Bavière contre la Prusse, le Juif organisait la révolution et démolissait la Prusse et la Bavière en même temps.
Je ne pouvais supporter cette maudite discorde parmi les races allemandes et fus heureux de retourner su front, où j'avais demandé à aller dès mon arrivée à Munich.
194 Au commencement de mars 1917, j'étais de nouveau à mon régiment.
* Vers la fin de l'année 1917, le point le plus bas du découragement de l'armée semblait surmonté. Toute l'armée avait puisé dans l'effondrement de la Russie une nouvelle espérance et un nouveau courage. La conviction que maintenant, malgré tout, le combat devait finir par une victoire de l'Allemagne, commença à s'emparer de la troupe. On pouvait de nouveau entendre des chants, et les corbeaux de malheur se firent plus rares. On croyait de nouveau en l'avenir de la patrie.
En particulier, la débâcle italienne de l'automne 1917 avait produit la plus merveilleuse impression ; on voyait, en effet, dans cette victoire, la preuve de la possibilité de percer également le front en dehors du théâtre des opérations russes. Le torrent d'une foi splendide se déversait maintenant dans le cœur de millions d'hommes et leur fit attendre avec une assurance réconfortée l'arrivée du printemps 1918. Par contre, l'ennemi était visiblement déprimé. Cet hiver-là, on fut plus tranquille que les autres fois. C'était le calme avant la tempête.
Le front entreprenait les derniers préparatifs pour mettre un terme définitif à l'éternel combat ; d'interminables transports de troupes et de matériel roulaient vers le front occidental et la troupe recevait des instructions en vue de la grande attaque. C'est alors que surgit en Allemagne le plus grand tour de coquin de toute la guerre.
Il ne fallait pas que l'Allemagne pût vaincre ; à la dernière heure, lorsque la victoire semblait déjà devoir s'attacher aux drapeaux allemands, on eut recours à un moyen qui semblait propre à étouffer d'un seul coup dans son œuf l'attaque allemande du printemps, a6n de rendre impossible la victoire :
On organisa la grève des munitions.
Si elle réussissait, le front allemand devait s'écrouler et le vœu du Vorwärts que, cette fois, la victoire ne suivît plus les drapeaux allemands, s'accomplissait. Du fait du manque de munitions, le front devait être percé en quelques semaines ; l'offensive était de la sorte enrayée, l'Entente sauvée, mais le capital international se rendait maître de
195 l'Allemagne, et le but intrinsèque de la tromperie marxiste des peuples était atteint.
La destruction de l'économie nationale, afin d'établir la domination du capital international - but atteint grâce à la sottise et la crédulité des uns, l'insondable lâcheté des autres.
Quoi qu'il en soit, la grève des munitions n'eût point le dernier succès espéré ; priver d'armes le front : elle dura trop peu pour qu'un manque de munitions eût condamné l'armée à sa perte. Mais combien plus terrible était le préjudice moral !
Premièrement : pour quoi l'armée combattait-elle encore, si le pays lui-même ne voulait plus de la victoire ? Pour qui les immenses sacrifices et privations ? Il fallait donc que le soldat combattît pour la victoire, tandis que le pays faisait la grève !
Deuxièmement : quelle était l'impression produite sur I'ennemi ?
En cet hiver 1917-1918, des nuages opaques montèrent au firmament des Alliés. Durant presque quatre ans, on avait exécuté des assauts contre le géant allemand et l'on n'avait pu l'abattre ; mais alors celui-ci n'avait de libre que son bras, celui tenant le bouclier, pour se défendre, tandis qu'il devait tirer le glaive pour frapper tantôt à l'Est, tantôt à l'Ouest, tantôt au Sud. Maintenant enfin, le géant était libre sur ses derrières. Des flots de sang avaient coulé jusqu'à ce qu'il réussît à abattre définitivement l'un des adversaires. Désormais à l'Ouest, le glaive devait se joindre au bouclier et puisque jusqu'ici l'ennemi n'avait point réussi à briser la défense, c'est lui-même qui devait être atteint par l'attaque. On la craignait et on tremblait pour la victoire.
A Londres et à Paris, les conférences se suivaient sans interruption. Même la propagande ennemie se fit plus difficile ; il n'était plus si facile de démontrer le peu de probabilité de la victoire allemande.
Il en était également ainsi sur les fronts, où un silence prudent régnait, pour les troupes alliées aussi. L'insolence dé ces messieurs avait subitement disparu. Une lueur inquiétante commençait également à leur apparaître. Leur contenance intérieure à l'égard du soldat allemand avait maintenant changé. Jusqu'à présent, ils pouvaient le considérer comme un fou condamné à la défaite ; mainte-
196 nant, ils avaient devant eux celui qui avait anéanti Ieur alliée russe. La nécessité qui nous avait été imposée de n'attaquer qu'à l'Est apparaissait maintenant comme une tactique géniale. Pendant trois ans, les Allemands avaient livré l'assaut à la Russie, au début sans le moindre succès apparent. On se moquait presque de ces inutiles entreprises, car enfin le colosse russe devait rester victorieux en raison de la supériorité du nombre de ses soldats. L'Allemagne, au contraire, devait périr par épuisement de sang. Les faits paraissaient confirmer ces espérances.
Depuis les jours de septembre 1914, lorsque pour la première fois les interminables troupes de prisonniers russes, provenant de la bataille de Tannenberg, commencèrent à rouler sur les routes de l'Allemagne, ce flot n'en finissait plus, mais de toute armée battue et anéantie une nouvelle armée prenait la place. Inépuisablement, le colossal empire des tzars livrait à la guerre ses nouvelles victimes. Combien de temps l'Allemagne pouvait-elle soutenir cette course ? Un jour ne devait-il pas arriver où, après une dernière victoire allemande, des armées russes qui ne ,seraient toujours pas les dernières entreraient dans la dernière de toutes les batailles ? Et quand cela ? D'après toutes les supputations, la victoire de la Russie pouvait, à la vérité, être encore différée, mais elle devait survenir immanquablement un jour.
Maintenant toutes ces espérances étaient perdues pour l'Entente. L'alliée, qui avait fait les plus grands sacri6ces de son sang sur l'autel des intérêts communs, était à bout de forces et gisait sur le sol devant son implacable agresseur. On craignait le printemps prochain. Et puisque, jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à briser l'Allemand, alors qu'elle n'avait pu s'installer sur le front Ouest, comment pouvait-on compter maintenant sur la victoire quand l'ensemble des forces de ce terrible pays de héros paraissait se masser pour l'attaque contre le front Ouest ?
Les ombres des montagnes du Tyrol méridional s'étendaient d'une façon oppressante sur l'imagination ; jusque dans les brouillards de Flandre, les armées battues de Cadorna engendraient la tristesse sur les visages, et la croyance à la victoire faisait place à la terreur devant la défaite fatale.
Alors, au moment où, dans les froides nuits, on croyait
197 déjà percevoir le grondement de l'avance des troupes d'assaut de l'armée allemande, et où l'on attendait dans une craintive inquiétude la décision qui s'annonçait, soudain jaillit de l'Allemagne une éclatante lumière rouge qui projeta sa lueur jusque dans le dernier trou d'obus du front.
Au moment où l'on donnait les dernières instructions aux divisions allemandes pour la grande attaque, la grève générale éclata en Allemagne.
D'abord le monde resta silencieux. Mais bientôt la propagande ennemie se jeta avec un soupir de soulagement sur cet appui de la douzième heure. D un seul coup, on avait trouvé le moyen de relever la confiance déclinante des soldats alliés. On présentait de nouveau comme certaine la probabilité de la victoire et l'on transformait en une assurance résolue l'inquiétude devant les événements imminents. Maintenant, on pouvait donner aux régiments qui attendaient l'attaque allemande, en vue de la plus grande bataille de tous les temps, la conviction que la décision sur la fin de cette guerre appartiendrait non à l'audace de l'assaut allemand, mais à une persévérante résistance contre ce dernier. Que les Allemands remportassent autant de victoires qu'il leur plaira, dans leur pays ce serait la révolution que l'on trouverait en y entrant, et non une armée exaltée par de nombreuses victoires.
Les journaux anglais, français et américains commencèrent à implanter cette croyance dans le cœur de leurs lecteurs, tandis qu'une propagande infiniment habile remontait vigoureusement le moral des troupes sur le front.
« L'Allemagne devant la révolution ! La victoire des alliés inévitable ! » Tel était le meilleur remède pour raffermir sur leurs jambes le poilu et le tommy chancelants. Maintenant, on pouvait rouvrir le feu des fusils et des mitrailleuses, et à une fuite éperdue dans une terreur panique succéda une résistance pleine d'espoir.
Tel était l'efFet de la grève allemande des munitions. Elle renforça la croyance des peuples alliés en la victoire et fit disparaître du front allié la déprimante désespérance ; par la suite, des milliers de soldats allemands durent payer cette grève de leur sang. Les instigateurs de cette méprisable grève, de misérables individus étaient cependant candidats aux plus hautes fonctions du gouvernement de l'Allemagne révolutionnaire.
198 Encore que, du côté allemand, il ait été possible de surmonter en apparence la répercussion tangible de ces événements, du côté de l'adversaire, les conséquences favorables furent durables. La résistance avait perdu le caractère de vanité qu'elle présentait pour une armée qui croyait tout perdu et elle fit place à l'acharnement de la lutte pour la victoire.
En effet, maintenant la victoire devait, selon toutes prévisions humaines, être aux alliés, si le front Ouest pouvait résister seulement pendant quelques mois à l'attaque allemande. Dans les parlements de l'Entente, on reconnut la possibilité d'un avenir meilleur et on accorda des sommes inouïes pour la propagande en vue de la désagrégation de l'Allemagne.
* J'avais eu le bonheur de pouvoir prendre part aux deux premières et à la dernière offensive.
Elles furent la plus prodigieuse impression de toute mon existence ; prodigieuse parce que, maintenant pour la dernière fois, ainsi qu'en l'année 1914, le combat avait perdu le caractère de la défensive et pris celui de l'offensive. On respira enfin dans les tranchées et les galeries de mines de l'armée allemande, lorsqu'enfin, après plus de trois ans passés dans l'enfer, vint le jour du règlement de comptes. Encore une fois, les bataillons victorieux furent transportés de joie et les dernières couronnes de l'immortel laurier se suspendirent aux drapeaux tout auréolés par la victoire. Encore une fois, les chants patriotiques retentirent le long des interminables colonnes en marche et montèrent vers le ciel, et, pour la dernière fois, la grâce du Seigneur sourit à ses enfants ingrats.
* Au fort de l'été 1918 (1), un morne accablement s'étendait
sur le front. La discorde régnait dans le pays. Pourquoi ? On racontait beaucoup de choses dans les divers corps de troupe. On disait que maintenant la guerre n'avait plus de but et que, seuls, des insensés pouvaient encore croire
(1) Erreur volontaire : les premiers troubles intérieurs datent de fin octobre 1918.
199 à la victoire. On prétendait que le peuple n'avait plus~ aucun intérêt à résister plus longtemps, mais seulement les capitalistes et la monarchie - ces bruits venaient de l'arrière et étaient discutés aussi sur le front.
Cela n'occasionna d'abord que fort peu de réaction sur le front ? Que nous importait le suffrage universel ? Est-ce bien pour cela que nous avions combattu près de quatre ans et demi ? C'était un méprisable acte de banditisme de ravir ainsi frauduleusement aux héros couchés dans la tombe le but de la guerre. Ce n'est pas avec le cri de « Vive le droit de vote universel et secret ! » que les jeunes régiments étaient allés un jour à la mort dans les Flandres, mais avec le cri de « l'Allemagne au-dessus de tout dans le monde ». C'était une petite différence qui n'était pas tout à fait insignifiante. Mais ceux qui réclamaient le droit de vote n'avaient point combattu là où ils voulaient le conquérir. Le front ne connaissait point toute la canaille des partis. On ne voyait qu'une petite partie de ces messieurs les parlementaires, là où se trouvaient les honnêtes Allemands qui n'étaient ni tortus ni bossus.
Ainsi les vieilles troupes du front étaient fort peu disposées en faveur de ce nouveau but de guerre de MM. Ebert, Scheidemann, Barth, Liebknecht et consorts. On ne comprenait absolument pas pourquoi, tout d'un coup, les embusqués pouvaient avoir le droit de s'attribuer le pouvoir dans le pays sans tenir compte de l'armée.
Dès le début, mon opinion personnelle était arrêtée.
Je haïssais au suprême degré tout ce tas de misérables vauriens de politiciens qui trompaient le peuple. Depuis longtemps, je voyais clairement que, dans toute cette coterie, il ne s'agissait point en réalité du bien de la nation, mais du remplissage de leurs poches vides. Et en les voyant maintenant prêts à sacrifier tout le peuple pour cela et, si besoin en était, à laisser périr l'Allemagne, je les considérais comme mûrs pour la corde. Tenir compte de leurs désirs, signifiait le sacrifice des intérêts des travailleurs du peuple au profit de quelques voleurs à la tire. Or, on ne pouvait faire cela qu'en sacrifiant l'Allemagne.
Telles étaient toujours les pensées de la plus grande partie des combattants de l'armée. Mais les renforts venant du pays étaient de plus en plus mauvais, de sorte que leur arrivée ne donnait aucun surcroît de force à la puissance
200 des combattants de l'armée, et au contraire l'affaiblissait. Particulièrement, la jeune classe n'avait, dans son ensemble, aucune valeur. Souvent il était difficile de croire que c étaient les fils du même pays que celui qui avait envoyé sa jeunesse au combat autour d'Ypres.
En août et en septembre, les manifestations de décomposition allèrent en augmentant de plus en plus rapidement, bien que l'impression produite par les attaques ennemies ne fût point comparable à celle de nos combats de résistance d'autrefois. La bataille de la Somme et de la Flandre étaient, en comparaison, des souvenirs de pire horreur.
A la fin de septembre, ma division occupa, pour la troisième fois, les positions que nous avions autrefois enlevées en combattant dans les régiments de jeunes volontaires de la guerre.
Quel souvenir !
En octobre et novembre 1914, nous y avions reçu le baptême du feu. Notre régiment était allé au combat comme pour une danse, avec l'amour de la patrie au cœur et la chanson aux lèvres. Le sang le plus précieux s'offrait avec joie, avec la foi de garantir ainsi l'indépendance et la liberté de la patrie.
En juillet 1917, nous foulâmes pour la deuxième fois ce sol devenu sacré pour nous. Car là sommeillaient nos meilleurs camarades, presque des enfants qui, autrefois, avaient couru à la mort pour leur chère patrie, le regard irradié d'enthousiasme !
Nous, les vieux qui marchions alors avec le régiment, nous nous arrêtâmes avec une pieuse émotion sur ce lieu où l'on avait juré la « fidélité et l'obéissance jusqu'à la mort ».
Ce terrain, que le régiment avait emporté d'assaut il y a trois ans, devait être maintenant défendu dans un dur combat défensif.
Par un feu roulant de trois jours, l'Anglais préparait la grande offensive des Flandres. Alors les esprits des morts semblèrent revenir à la vie ; le régiment s'accrocha à la boue vaseuse, se cramponna aux trous et aux entonnoirs isolés, et ne céda point, ne fléchit point. Mais, comme autrefois déjà, il diminua, s'éclaircit sur place, jusqu'à ce qu'enfin l'offensive des Anglais se déchaînât le 31 juillet 1917.
Dans les premiers jours d'août, nous fûmes relevés.
201 Du régiment il ne restait plus que quelques compagnies qui revinrent en chancelant vers l'arrière, couvertes d'une croûte de boue, ressemblant plutôt à des fantômes qu'à des hommes. Mais l'Anglais n'avait trouvé, en plus de quelques centaines de trous d'obus, que la mort.
Maintenant, en automne 1918, nous étions pour la troisième fois sur le terrain d'assaut de 1914. Le village de Comines qui nous avait autrefois servi de lieu de repos, était devenu maintenant un champ de bataille. A la vérité, bien que le terrain de combat fût resté le même, les hommes avaient changé : désormais, on faisait de la politique dans la troupe. Le poison venu du pays commençait à agir ici comme partout, mais l'allant de jadis, qui venait de la maison, faisait complètement défaut.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre, le tir des obus à gaz des Anglais se déchaîna sur le front sud d'Ypres ; ils y employaient le gaz à croix jaune dont nous ne connaissions pas les effets, tant qu'ils ne se manifestaient pas sur notre propre corps. Je devais les connaître dans cette nuit même. Sur une colline au sud de Wervick, nous nous trouvâmes pris, dès le soir du 13 octobre, durant de longues heures, sous un feu roulant d'obus à gaz. Cela continua toute la nuit avec une plus ou moins grande intensité. Vers minuit, une partie d'entre nous furent évacués, parmi eux quelques-uns disparus pour toujours, Vers le matin, la douleur s'empara de moi, augmentant de quart d'heure en quart d'heure, et, à 7 heures du matin, je revins en trébuchant et chancelant vers l'arrière, les yeux en feu, emportant avec moi ma dernière affectation de la guerre.
Quelques heures plus tard, mes yeux se changèrent en charbons ardents et les ténèbres se firent autour de moi. C'est ainsi que je vins à l'hôpital de Pasewalk, et là j'eus la douleur d'assister à la révolution.
* Il régnait déjà depuis longtemps dans l'air quelque chose d'indéfinissable et de répugnant. On se racontait les uns aux autres que, dans quelques semaines, cela allait commencer, mais je ne pouvais pas me représenter ce qu'il fallait entendre là-dessous. Je pensais tout d'abord à une grève comme celle du printemps. Des bruits défavorables venaient continuellement de la marine, où, à ce que l'on
202 disait, l'effervescence régnait. Mais ceci me paraissait devoir être plutôt le produit de l'imagination de jeunes gens isolés qu'un sujet intéressant les grandes masses. A l'hôpital même, chacun parlait bien de la fin de la guerre que l'on espérait voir arriver bientôt, mais personne ne comptait sur une solution immédiate. Je ne pouvais lire les journaux.
Au mois de novembre, la tension générale s'augmenta.
Et, un jour, la catastrophe fit soudain sa brusque irruption. Des matelots arrivèrent en camions automobiles et excitèrent à la révolution ; quelques jeunes Juifs étaient les « chefs » de ce mouvement pour « la liberté, la beauté et la dignité » de l'existence de notre peuple. Aucun d'eux n'avait jamais été sur le front. Par le biais d'un hôpital de vénériens, les trois orientaux avaient été refoulés de la zone désarmée vers l'arrière. Maintenant, ils y hissaient le chiffon rouge.
Dans les derniers temps, je me sentis un peu mieux. Ma douleur perçante dans les orbites cessa ; lentement je pus commencer à distinguer sous des contours grossiers ce qui m'entourait. Je pus me bercer de l'espoir de recouvrer la vue, tout au moins suffisamment pour pouvoir exercer plus tard un métier. A la vérité, je ne pouvais plus espérer être jamais en état de dessiner. Toujours est-il que je me trouvais ainsi en voie d'amélioration, lorsque l'affreuse chose arriva.
Mon premier espoir était toujours qu'il ne s'agissait dans cette trahison envers la patrie que d'une affaire plus ou moins locale. Je tentais d'affermir dans ces idées quelques camarades. En particulier mes camarades bavarois de l'hôpital y étaient plus qu'accessibles. L'état d'esprit n'était rien moins que révolutionnaire. Je ne pouvais pas me figurer qu'â Munich également, la démence allait se déchaîner. La fidélité envers la noble maison des Wittelsbach me paraissait devoir être plus solide que la volonté de quelques Juifs. Ainsi je pouvais croire uniquement qu'il s agissait d'un putsch de la marine, lequel serait écrasé dans quelques jours.
Les jours suivants arrivèrent, et avec eux la plus affreuse certitude de ma vie. Les bruits qui couraient devenaient toujours plus accablants. Ce que j'avais pris pour une affaire locale était, disait-on, une révolution générale. Là-dessus arrivèrent les ignominieuses nouvelles du front.
203 On voulait capituler. Mais une chose pareille était-elle possible ?
Le 10 novembre, un pasteur vint à l'hôpital militaire pour nous faire une petite allocution ; alors nous apprîmes tout.
J'étais ému au plus haut point en l'écoutant. Le vieil et digne homme paraissait trembler fort, quand il nous fit connaître que, maintenant, la maison des Hohenzollern n'avait plus le droit de porter la couronne, que notre patrie était devenue « république », que l'on devait prier le Tout-Puissant pour qu'il ne refuse pas sa bénédiction à ce changement de régime et qu'il veuille bien ne pas abandonner notre peuple dans les temps à venir. En même temps, il ne pouvait faire autrement que de dire quelques mots sur la maison royale, voulant rendre hommage aux services qu'elle avait rendus en Poméranie, en Prusse et à toute la patrie allemande, et, comme il commençait à pleurer doucement et tout bas, le plus profond abattement envahit tous les cœurs dans la petite salle et ie crois qu'aucun de nous ne put retenir ses larmes. Mais lorsque le vieil homme tenta de reprendre son discours et commença à exposer que nous étions obligés maintenant de mettre fin à la guerre, qu'à l'avenir notre patrie serait exposée à une dure oppression, parce que maintenant la guerre était perdue et que nous devions nous en remettre à la grâce du vainqueur, qu'il fallait accepter l'armistice avec la confiance dans la magnanimité du vainqueur, alors je ne pus y tenir. Il me fut impossible d'en entendre davantage. Brusquement, la nuit envahit mes yeux, et en tâtonnant et trébuchant je revins au dortoir où je me jetai sur mon lit et enfouis ma tête brûlante sous la couverture et l'oreiller.
Depuis le jour où je m'étais trouvé sur la tombe de ma mère, je n'avais plus jamais pleuré. Lorsque, dans ma jeunesse, le destin s'abattit impitoyablement sur moi, ma fierté se développa. Lorsque, durant les longues années de la guerre, la mort ravit dans nos rangs tant de nos chers camarades et amis, il m'aurait presque semblé commettre un péché de les pleurer, car ils moururent pour l'Allemagne ! Et lorsqu'enfin - dans les derniers jours du terrible combat - le gaz m'assaillit furtivement et commença à me dévorer les yeux, devant la crainte de devenir aveugle je pensai un instant désespérer ; alors je fus frappé comme
204 par la foudre, par la voix de ma conscience : « Misérable pleurnicheur, tu vas gémir alors que des milliers sont cent fois plus malheureux que toi ! » et insensible et muet, je supportai mon sort. Maintenant seulement je vis comme disparaît toute souffrance personnelle devant le malheur de la patrie.
Ainsi, vains étaient tous les sacrifices et toutes les privations ; c'est en vain que l'on avait souffert de la faim et de la soif durant d'interminables mois, vaines les heures pendant lesquelles, serrés par l'angoisse de la mort, nous accomplissions néanmoins notre devoir ; inutile, le trépas de deux millions d'hommes qui trouvèrent la mort.
Les tombes n'allaient-elles pas s'ouvrir, de ces centaines de milliers d'hommes qui sortirent un jour des tranchées pour ne plus jamais revenir ? Ne devaient-elles pas s'ouvrir et envoyer, comme des fantômes vengeurs, les héros muets, couverts de boue et de sang, vers la patrie qui, dans une telle dérision, les frustrait du suprême sacrifice que l'homme peut faire à son peuple dans ce monde ? Etait-ce pour cela qu'étaient morts les soldats d'août et septembre 1914 et qu'en automne de la même année, les régiments de volontaires avaient suivi leurs vieux camarades ? Etait-ce pour cela que ces enfants de dix-sept ans étaient tombés dans la terre des Flandres ? Etait-ce le but du sacrifice que la mère allemande offrait à la patrie, lorsque, d'un cœur douloureux, elle laissait partir pour ne jamais les revoir ses enfants infiniment chers ? Tout ceci ne s'était-il passé que pour qu'une poignée de criminels pût mettre la main sur le pays ?
C'était donc pour cela que le soldat allemand, épuisé par les nuits sans sommeil et les marches interminables, avait tenu bon sous l'ardeur du soleil et les tempêtes de neige ? Etait-ce pour cela qu'il avait subi l'enfer du feu roulant et la fièvre du combat de gaz, sans fléchir, se souvenant toujours de son unique devoir : préserver la patrie contre le danger de l'ennemi ?
Véritablement, ces héros méritaient aussi que leur fût érigée une pierre :
« Passant, toi qui vas en Allemagne, apprends au pays que nous gisons ici, fidèles à la patrie et obéissants au devoir. »
Et le pays ?
Mais est-ce bien le seul sacrifice que nous ayons à considérer ? L'Allemagne du passé . devait-elle être moins
205 estimée ? N'y avait-il pas aussi des devoirs envers notre propre histoire ? Etions-nous encore dignes de nous parer de la gloire du passé ? Et comment devait être présentée aux générations futures la justification de cet événement ?
Misérables ! Dépravés ! Criminels !
Plus je tâchais d'y voir clair dans ces affreux événements, plus le rouge de la honte me montait au front en face de cette ignominie. Qu'était la douleur dont avaient souffert mes yeux en comparaison de cette détresse ?
D'affreuses journées et des nuits pires encore suivirent ; je savais que tout était perdu. Seuls, de complets insensés ou des menteurs et des criminels pouvaient en arriver à espérer en la clémence de l'ennemi. Dans ces nuits naquit en moi la haine, la haine contre les auteurs de cet événement.
Dans les jours suivants, je devais aussi être fixé sur mon sort. Je devais maintenant rire en pensant à mon propre avenir qui, encore peu de temps auparavant, m'avait causé de si amères inquiétudes. N'était-ce pas ridicule de vouloir bâtir des maisons sur un tel terrain ? Enfin je vis clairement que maintenant était arrivé ce que j'avais déjà si souvent appréhendé, mais n'avais jamais pu croire de sang-froid.
L'empereur Guillaume II était le premier empereur d'Allemagne qui avait tendu la main pour la réconciliation aux chefs du marxisme, sans se douter que les fourbes n'avaient point d'honneur. Tandis qu'ils tenaient encore la main de l'empereur dans la leur, l'autre cherchait le poignard.
Avec le Juif, il n'y a point à pactiser, mais seulement à décider : tout ou rien !
Quant à moi, je décidai de faire de la politique.
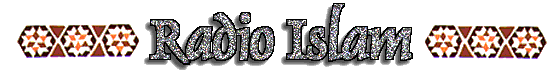
HOME
![]()
Svenska
![]()
English
![]()
German
![]()
French
![]()
French
![]()
English
![]()
German
![]()
Italian
![]()
Spanish.
![]()
Norsk
The Jewish
Plots!
Must
Germany
Perish?
A Jewish plan
for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her
people!
| English
|
French
|
Deutsch
| Svenska
|
Portug
|
Russian
|
Spanish
|
|
English
|
French
|
Deutsch
|
Svenska
|
Portug
|
Russian
|
Spanish
|
Italian
|
Danish
|