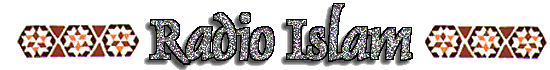
Roger Garaudy
L'AVENIR : MODE D'EMPLOI
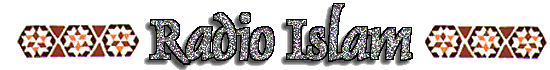
Roger Garaudy
L'AVENIR : MODE D'EMPLOI
Le deuxième postulat sur lequel se fonde la civilisation occidentale depuis la Renaissance, concerne les rapports de l'homme avec la nature. C'est ce que j'appelle : Le Postulat de Descartes.Dans son Discours de la méthode (1637) Descartes (1596-1650) formule ainsi son objectif : " Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. "
Descartes est le contemporain de Hobbes avec lequel, d'ailleurs, il entretient une correspondance polémique. Mais il appartenait à la même époque où l'homme était, par l'individualisme inhérent au système naissant, privé de ses dimensions proprement humaines : le rapport avec l'autre homme, la communauté, l'amour. L'autre n'a de rapport avec moi-même que comme négation et comme agression. Ce sera un trait permanent de cette civilisation, depuis Hobbes qui en a, nous l'avons vu, défini le principe : "l'homme est un loup pour l'homme " jusqu' à l'ultime soupir de cette mort de l'homme : "l'enfer c'est les autres", formulé par un héros de Sartre.
Il ne restait plus, dans la perspective du système né en Angleterre que la forme la plus pauvre de la philosophie de l'être : le tête à tête entre l'individu, privé de ses dimensions proprement humaines, de ses relations avec les autres et avec le tout, et une nature réduite par l'empirisme anglais à la seule connaissance des apparences sensibles, que l'on considère l'ensemble de ces perceptions comme la seule réalité matérielle, dont nous ayons l'expérience, selon la tradition réaliste de Hobbes et Locke, ou que ces sensations soient un langage que Dieu nous parle, selon la conception immatérialiste de l'évêque Berkeley.
Descartes s'oppose à cet empirisme, mais part de la même conception insulaire, individualiste, de l'homme, pour concevoir d'autres rapports avec la nature, mais sans sortir du dualisme fondamental de la philosophie de l'être.
Pour suivre son cheminement il est nécessaire de réfléchir sur ce qui est pour lui le point de départ, la certitude première d'où découlera le système tout entier : "Douterais-je de tout, il est certain que je doute : je pense donc je suis. "
" Je pense donc je suis. " Il serait difficile de dire plus de sottises en aussi peu de mots. D'escamoter en cinq mots quatre postulats.
1 -- Je. Même Robinson, homme fruste isolé dans une île, n'aura pas cette illusion naïve.
Je. Il n'est pas vrai qu'au commencement était moi. Tout au contraire je me distingue peu à peu, et à grand-peine, d'une totalité confuse des choses et des autres vivants. C'est une conquête de mon enfance première : le moment où je m'affirme comme individu, distinct de tous les autres, séparé, sinon affronté. Cette affirmation individualiste est historiquement datée et géographiquernent située : elle est née avec la Renaissance, et en Europe. Il est vrai qu'à partir de cette mutation historique caractérisée par l'institution généralisée du marché et de ses concurrences, chaque homme est devenu le rival de chaque autre, la liberté a été cadastrée comme la propriété : ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre.
Il est vrai aussi que cet individualiste, barricadé dans son moi égoïste, a considéré l'Europe comme le nombril du monde : tous les autres n'étant que barbares ou primitifs.
Les Indiens ont-ils une âme ? se demandaient gravement les gens d'Eglise au XVIè siècle. Il fallut plusieurs papes pour en décider.
2- " Je connus que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature est de penser. " Cette maladie vient de plus loin, de Socrate et de Platon ; tout ce qui ne peut se traduire en concepts n'existe pas. Descartes pousse cette désolation à son terme : l'amour, la création esthétique, l'action même (autre que technique), où ont-ils leur place ? Essayez de tirer une esthétique de Descartes ! Ou d'apprendre de lui ce qu'est l'amour ! Un soir de tristesse vous chercherez dans ce traité de mécanique qui s'appelle, curieusement, Traité des passions.
3 -- Donc. De quelle logique peut se réclamer cette conclusion ? Quelle distance y a-t-il entre ma pensée et moi ? Entre mon amour et moi ? Entre mon acte et moi ? Et si elle existait, quel raisonnement pourrait la franchir ? Comment recoller les morceaux de cet homme déchiqueté : ici l'âme, et là le corps, ici moi et là les autres ?....
4 -- Je suis. Quelle est cette substance cette essence, cette nature ? que l'on pourrait saisir comme une chose extérieure (comme les choses sont extérieures aux choses) distincte de l'action elle-même comme une machine peut-être décrite par le géomètre avant son fonctionnement et indépendamment de lui.
Comment Descartes va-t-il sortir de sa cogitation insulaire ?
D'abord, il faut un corps à cette âme pensante. Notre étrange rationaliste y pourvoit par la plus irrationnelle des hypothèses : le pont pour franchir le gouffre entre l'âme pensante et le corps, c'est la glande pinéale : un petit bout de viande sera la passerelle inespérée pour recoller au monde. Même Aristote n'avait pas eu recours à un tel coup de force métaphysique pour surmonter le dualisme de sa philosophie de l'être : l'être et la pensée se contentaient d'une coexistence pacifique.
Ensuite, pour que la nature, désespérément extérieure à cette pensée insulaire, ne soit pas une illusion, il fallait un garant de son existence réelle. Ici Descartes fait appel à un subterfuge moins inattendu que celui de la glande pinéale : Dieu se portera caution de la réalité du monde extérieur. Mais quel Dieu ? ll ne peut être que consubstanciel à la seule vérité jusque là indubitable pour Descartes : la pensée. Il n'a donc plus besoin d'une glande pinéale pour passer de la pensée à la nature. Il a recours à la bonne vieille scolastique traditionnelle depuis Saint Anselme (1033-1109) déduisant Dieu de l'idée que l'on s'en fait : nous avons l'idée d'un être parfait : " Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé ; or cette perfection absolue implique l'existence ; donc l'être parfait existe. " Le tour est joué : cet argument ontologique nous a fait débarquer sur la terre, nous a donné une nature, après quoi, ce Dieu magicien ne sera plus utile à Descartes. Il semble même n'y point croire : dans un moment de franchise, il dira : " Je garde le Dieu de ma nourrice. "
Les théologiens ne furent pas dupes: ils interdirent l'enseignement du cartésianisme à la Sorbonne.
En effet, en dépit des contorsions métaphysiques de Descartes, sa conception mécaniste du monde ne sera que l'anticipation de ce que les athées du XVIIIème siècle, comme Voltaire, appelleront la chiquenaude originelle de l'horloger qui est à l'origine du mouvement, de la vie mécanique du monde.
Ayant pris pied, avec la glande pinéale et Saint Anselme, dans le monde corporel et matériel, il n'a plus que faire de ce Dieu pour construire sa physique mathématique, qu'il applique d'abord à l'optique pour étudier la réfraction, puis à l'étude des appareils de levage, et qu'il étend à toute la nature, (" la physique, dit-il, n'est autre que géométrie."). Le mouvement mécanique (celui que l'on explore à partir des mathématiques de son temps), explique tout, par exemple la biologie. Il n'y a dans les êtres vivants, rien de plus que dans les automates que Descartes dit avoir aperçus dans les jardins de nos rois , et dans la construction desquels excella Vaucanson. Tout animal n'est qu'une machine, et l'homme n'y échappe que par un miracle divin, qui, par la glande pinéale, a mis son corps en rapport avec son âme. Il suffira, avec plus de cohérence, de faire abstraction de cette étrange connexion, pour passer, au siècle suivant, de l'animal machine de Descartes, à l'homme machine de Lamettrie.
Ainsi avec de l'étendue (explorable par la géométrie analytique dont il fut l'inventeur) et le mouvement dont l'impulsion première est un présent de Dieu, Descartes nous rend comme maîtres et possesseurs de la nature. Il est, à ce titre, le père de la civilisation technicienne réduisant la raison à sa fonction instrumentale, comme moyen de puissance et de richesse.
A partir de là sont exclus tout sens et toute finalité de la vie. Pas plus qu'aucune autre philosophie de l'être celle-ci n'est capable de fonder une morale qui ne soit pas une morale de la résignation à ce qui est. La preuve en est donnée par l'impuissance de Descartes à fonder une morale autre que provisoire. Comme dans toute philosophie de l'être, elle ne peut être que conformisme et résignation à l'ordre établi. Elle consiste, nous enseigne son Discours de la Méthode à obéir aux lois et aux coutumes et à se gouverner "suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès ", "tâcher plutôt à se vaincre que la fortune " et " à changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde." Le mot d'ordre de la pensée unique et du politiquement correct y puise sa source. Lorsque, réfugié à Stockholm, la reine Elisabeth lui demande comment l'homme peut assigner à sa vie un sens et des fins, Descartes est impuissant à répondre, et se contente d'un bricolage (comme dirait Lévi-Strauss) du stoïcisme ou de l'épicurisme pour en revenir à la seule préoccupation cartésienne de la domination technique du monde qui fera dire avec juste raison à Michel Serres que " le Discours de la Méthode est un traité de la guerre ". En tout cas, un manuel de la puissance technique ne se posant même pas le problème des fins. Tout comme ne se le posa jamais l'officier de cavalerie mercenaire René Descartes, se mettant au service (en cette période de guerres religieuses sanglantes) aussi bien des troupes protestantes de Maurice De Nassau en 1618 luttant contre l'Espagne pour l'indépendance des Pays Bas, que de celles, catholiques, de Maximilien de Bavière en 1619, combattant au côté des Habsbourg pour détruire l'indépendance de la Bohéme à la bataille de la Montagne Blanche, près de Prague, le 8 novembre 1620, ouvrant pour tout un peuple la période des ténèbres.
Cette mentalité de mercenaire et de conquistador, servait admirablement la civilisation marchande et coloniale qui allait prendre son essor. La philosophie correspondante, celle d'une raison réduite à ses fonctions techniciennes, instrument de puissance et de richesse, devint, pour trois siècles, l'idole vénérée du système social triomphant, de ses lumières et de son progrès, jusqu'au milieu du XXème siècle où, après la découverte de la physique des quanta et de la relativité, put être conçue, avec Gaston Bachelard, une épistémologie non cartésienne.
* * * La philosophie des lumières du XVIIIsiècle, qui connut, en France son plus grand essor, est un cartésianisme émondé de ses fragiles superstructures théologiques ou pinéales et débouchant par conséquent sur un matérialisme mécanique radical, comme il apparaît chez le médecin Lamettrie (1709-1781) avec l'homme machine (1748) suite logique de la conception cartésienne de l'animal machine.
Helvetius (1715-1771), fermier général du roi et admirateur du système politique anglais, comme en témoigne sa correspondance londonienne, donne une vision plus ample de cet humanisme décharné en s'inspirant des thèses de l'anglais Locke (1632-1704) sur l'expérience.
Diderot (1713-1784) conçoit, avec son Encyclopédie la "Somme des sciences de son temps " mais sans dépasser les limites de la pensée bourgeoise : " le propriétaire seul est citoyen", écrit-il dans l'article Représentant de son Encyclopédie.
En dépit de son dogmatisme cartésien ce matérialisme français du XVIIIème siècle joua un rôle historique positif en donnant un fondement idéologique à la lutte contre la féodalité et sa légitimation par une religion figée justifiant le droit divin des rois et des privilèges du sang, comme, au siècle précédent, Bossuet avait cautionné la monarchie absolue à partir d'une Politique tirée de l'Ecriture Sainte.
Ce rôle révolutionnaire du matérialisme français ne saurait être extrapolé à toutes les formes du matérialisme : le matérialisme anglais de Hobbes avait aussi bien justifié le despotisme absolu dans son Léviathan, alors que Karl Marx se déclare l'héritier de l'idéalisme allemand. Son compagnon Engels écrira à la fin de sa vie (1891) : " Nous, socialistes allemands nous sommes fiers de tirer nos origines non seulement de Saint Simon, Fourier et Owen, mais aussi de Kant, de Fichte et de Hegel ". (Oeuvres de Marx et Engels Ed. russe. T.XV, p.625). Il redit encore, en 1874, dans sa Préface à La révolution démocratique bourgeoise en Allemagne (Ed. Sociales p. 23) : " S' il n'y avait pas eu précédemment la philosophie allemande, notamment celle de Hegel, le socialisme scientifique n'eût jamais existé. "
Et Marx lui-même dit du matérialiste Feuerbach : " Si on le compare à Hegel, Feuerbach est très pauvre. " (Lettre à Schweitzer du 24-1-1865)
Ceci nous permet d'interpréter correctement la formule de Marx, (qui se considérait comme un disciple critique de Hegel), lorsqu'il dit qu'il a "remis sur ses pieds la dialectique de Hegel. ": ce renversement ne signifie pas que Marx a dit matière là où Hegel disait esprit, ce qui nous eût ramené au matérialisme dogmatique antérieur. Cela signifie : passage d'une philosophie de l'être à une philosophie de l'acte.
Du point de vue théorique le matérialisme français issu de Descartes, c'est la lutte contre la religion et la métaphysique au profit du développement des sciences de la nature.
A ce matérialisme Marx fait deux reproches.
D'abord en la prenant dans l'état où le présentait une science mécaniste, le matérialisme prémarxiste a une conception très pauvre de la matière, qui n'est plus qu'un fantôme abstrait, obéissant aux seules lois de la mécanique.
Ensuite et surtout, il prétend s'installer dans les choses au lieu de partir de l'activité pratique des hommes : " Le principal défaut de tout le matérialisme passé -- y compris celui de Feuerbach, est que l'objet, la réalité, le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que pratique, de façon subjective, c'est ce qui explique pourquoi le coté actif fut développé par l'idéalisme, en opposition au matérialisme, mais seulement abstraitement, car l'idéalisme ne connaît naturellement pas l'activité réelle, concrète, comme telle. " (11)
Le matérialisme français du XVIIIe siècle, celui de d'Holbach, d'Helvétius, de La Mettrie, a cédé à une double illusion : l'illusion scientiste qui consiste à projeter dans la nature, comme si elles constituaient son essence définitive, les lois scientifiques actuellement connues à un moment déterminé du développement des sciences de la nature, à appauvrir ainsi le concept de matière jusqu'à le réduire par exemple au squelette décharné de la géométrie ou de la mécanique, alors que chaque grande découverte scientifique enrichit le concept philosophique de matière, comme le soulignera Engels dans son Ludwig Feuerbach en flétrissant " la forme plate, vulgaire, sous laquelle le matérialisme continue à exister aujourd'hui. " (12)
La deuxième illusion, plus fondamentale, et dont la première n'était qu'un corollaire, c'était l'illusion dogmatique, prétendant faire abstraction de la pratique, de l'activité de la connaissanoe et, par conséquent, de son caractère historique et historiquement relatif, pour se référer, à la manière des empiristes, à de prétendues données, comme si un fait n'était pas, précisément, ce qui a été fait, construit, par la technique et la pensée des hommes dans leur oeuvre plusieurs fois millénaire de transformation de la nature.
* * * La révolution française marqua une césure dans l'histoire de la philosophie comme dans l'histoire politique de l'Europe.
A la charnière de cette mutation se situe l'oeuvre de Condorcet (1743-1794) qui formula le premier d'une manière systématique le mythe du progrès sous la forme même où il continue, malgré tous les démentis de l'histoire réelle, à hanter les esprits depuis deux siècles, prenant le relais du mythe de la Providence qui avait régné jusqu'au XVIIème siècle. Ce mythe se perpétuera sous des formes diverses au XIXème siècle avec Auguste Comte et sa loi des trois états, et au XXème siècle avec les notions de croissance ou de développement quantitativement mesuré par le produit national brut (PNB)
Condorcet était un mathématicien et un esprit encyclopédique qui devint Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1773.
Les performances de la révolution industrielle du XVIII ème siècle l'avaient persuadé que le développement des techniques et des sciences était indéfini et que ce pouvoir sans limites de l'homme sur la nature pourrait assurer le bien être de tous par un accroissement indéfini de la richesse.
Il ne partageait pas l'optimisme béat d'Adam Smith qui s'en tenait à la production incessante de la richesse des nations sans se soucier de leur répartition : le 12 mars 1792, dans un exposé financier à l'Assemblée législative, dont il était Président, il notait déjà : " Toute grande société riche renfermera un grand nombre de pauvres, elle sera donc malheureuse et corrompue. " Mais ce n'était là, selon lui, qu'une étape passagère, qui exigeait, pour corriger ces déséquilibres, " des établissements qui offriraient des secours et des ressources à la partie pauvre de la population. "
Ce n'était donc, pour lui, qu'une crise de croissance du système. Dans son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain publié en 1794, l'année même où, décrété d'accusation par les Girondins, il se cacha, puis, découvert, se suicida, il montre qu'un développement sans fin des inventions de la science et de la technique, lié à une éducation généralisée, permettra un progrès sans fin du bonheur de l'humanité.
Ce bonheur est quantifiable puisqu'il se mesure par le pouvoir croissant de l'homme sur la nature, c'est à dire sur le rendement croissant du machinisme industriel, et sur la richesse produite par cette productivité.
Le projet était généreux puisqu'il devait à tous assurer ce bonheur, mais il fut aussitôt démenti par les orgies du capitalisme créant, en même temps, des richesses de plus en plus abondantes, et une masse croissante d'esclaves et d'exclus, avec une accumulation de la richesse à un pôle de la société en faveur d'une minorité de plus en plus restreinte, et de la misère à l'autre, avec une multitude croissante des exploités, même dans les pays riches et, plus encore, dans les pays où la dépendance coloniale engendrait le sous-développement.
L'autre objection, plus fondamentale, au mythe du progrès, découle du choix même des critères du bonheur. Il s'agit là du problème des fins et du sens de la vie, et nous en traiterons en examinant le 3ème postulat (religieux) de la civilisation occidentale : de Faust au monde du non-sens.
Nous nous en tiendrons, pour le moment, au bilan du projet cartésien : nous rendre maîtres et possesseurs de la nature.
Cet objectif a été si bien atteint par les sciences et les techniques que nous avons le pouvoir de détruire cette nature. La bombe d'Hiroshima a fait en un instant 70.000 morts, (ce qui est un progrès incontestable par rapport à Gengis Khan à qui il fallut 7 jours pour ériger une pyramide de seulement 10.000 crânes, lorsqu'il prit Ispahan).
Les puissances nucléaires possèdent aujourd'hui un stock équivalent à plus d'un million de bombes d'Hiroshima, c'est à dire la possibilité technique de détruire 70 milliards d'êtres humains : douze ou quinze fois plus qu'il n'en existe sur la terre. Le pouvoir d'effacer toute trace de vie.
Ce n'est là qu'un cas limite ; le suicide planétaire au ralenti semble assuré : la destruction de la couche d'ozone par nos pollutions industrielles nous menace, d'ici trente ans, d'un réchauffement de l'atmosphère de plusieurs degrés, donc d'une fonte des glaces des pôles suffisante pour submerger les grandes villes portuaires, même si l'on parvient à empêcher la folie de l'exploitation de l'Antarctique qui accélèrerait encore le réchauffement de l'atmosphère en dégradant ce régulateur du froid.
Le rôle dévastateur du marché ne s'arrête d'ailleurs pas là : les seules considérations de rationalité économique et de rentabilité à court terme font du marché de la construction et de l'urbanisme le plus terrible prédateur des espaces urbains et suburbains par le développement cancéreux de constructions anarchiques. Les incendies, faisant place nette pour les terrains à bâtir, coûtent, en forêts, la surface d'une Autriche par an (où à transformer en paturages plus rentables).
Dans la forêt tropicale, en Amazonie par exemple, la rapacité des colons pour leur élevage extensif coûte 24 hectares par jour, mettant en danger la respiration de 5 milliards d'hommes, et l'exode, d'ici trente ans, d'un milliard d'entre eux chassés par la désertification.
Ce ne sont là que quelques exemples des progrès réalisés dans la maîtrise et la possession de la nature, posant les problèmes proches de l'épuisement des sols par les traitements chimiques, et, après la terre, de la pollution de l'air qui fait déjà des victimes dans les villes tentaculaires défigurées par les spéculations mercantiles de l'urbanisme des promoteurs et des transports automobiles anarchiques ; des massacres de la mer et de ses ressources poissonnières ; de l'épuisement des énergies fossiles non renouvelables comme le pétrole. L'eau, l'air, la terre, tout le milieu nécessaire à la vie étant ainsi menacé, l'on peut se demander, si nous continuions dans cette voie suicidaire, si la planète ainsi gérée sera encore habitable jusqu'à la fin du XXIème siècle.
* * * c -- Du postulat de Faust au monde du non-sens.
Il y eut un moment, dans l'histoire de l'Occident, avec le postulat du premier Faust, celui de Marlowe : " Homme, par ton cerveau puissant, deviens un Dieu ", où même des géants de la pensée comme Goethe, Kant, Fichte ou Hegel purent croire vraiment que l'homme allait pouvoir prendre le relais de Dieu dans la gérance du monde.
" De ce jour et de ce lieu commence une époque nouvelle de l'histoire humaine ", disait Goethe à Valmy.
* * * La philosophie allemande constitue une exception (d'ailleurs grandiose) dans la pensée occidentale.
L'Allemagne, le dernier pays, au XIXème siècle, à réaliser son unité, était émiettée en une poussière de principautés d'origine féodale ne participant que depuis la Révolution française et l'invasion napoléonienne, par procuration ou par importation, au mouvement général de l'Europe capitaliste dont l'Angleterre avait été la pionnière, continuée par la France.
Ces petites principautés féodales ne pouvaient donc pas, comme l'Angleterre ou la France, engendrer leurs intellectuels organiques en raison du retard et de l'exiguïté de ces états nains, survivances du passé médiéval de l'Occident.
Cela fit à la fois la grandeur et les limites de la philosophie allemande : les géants élaborèrent leurs doctrines à partir de l'expérience des autres.
Le Cardinal de Cues réfléchit longuement sur l'Islam à son apogée et sur les civilisations de l'Orient. Leibniz entrevit l'importance de la philosophie chinoise. Ces deux génies dépassèrent ainsi l'orbite occidentale. Ils ne participaient pas à ses sécessions.
Mais une influence, extérieure à celle des minuscules principautés, exerça une influence décisive sur les géants de la pensée allemande au XIX ème siècle (Kant, Fichte, Hegel) : celle de la Révolution française qui balayait les étroitesses anciennes. Tous furent bouleversés par cette mutation de l'histoire qu'ils n'avaient pu concevoir ni construire dans les isoloirs idéologiques de leurs terroirs minuscules et arriérés. Comme l'écrit Marx : "Ils ont pensé ce que les autres ont fait". Et la défaite finale de cette révolution avec sa restauration du passé, a entraîné plusieurs d'entre eux à la nostalgie et à la régression (philosophique et politique) comme nous l'avons vu, par exemple avec Fichte et Hegel, se résignant à "hurler avec les loups". Un autre exemple, est celui de la résignation du grand Goethe. Marx disait déjà de lui : "Le poète géant de Faust s'efface devant le ministre insignifiant de Weimar".
Ces faillites personnelles finales ne sauraient nous faire oublier les oeuvres puissantes de l'âge de leur grandeur liée à une grande espérance historique.
1 -- Les derniers chevaliers de l'esprit : Fichte, Hegel.
Fichte (1762-1814) identifie la révolution copernicienne de Kant par laquelle, sur le plan pratique et sur le plan théorique, est fondée l'autonomie souveraine de l'homme, et la Révolution française créant un droit nouveau et un monde nouveau à partir du principe de l'autonomie souveraine de l'homme et de sa raison.
Il offre ses services à la France pour lui proposer sa philosophie comme fondement théorique de sa Révolution.
" Mon système est le premier système de la liberté. De même que cette nation (la France) délivra l'humanité des chaînes matérielles, mon système la délivra du joug de la Chose en soi, des influences extérieures, et ses premiers principes font de l'homme un être autonome. La Doctrine de la science est née durant les années où la nation française faisait, à force d'énérgie, triompher la liberté politique ; elle est née à la suite d'une lutte intime avec moi-même et contre tous les préjugés ancrés en moi, et cette conquête de la liberté a contribué à faire naître la "Doctrine de la science"; je dois à la valeur de la nation française d'avoir été soulevé encore plus haut ; je lui dois d'avoir stimulé en moi l'énergie nécessaire à la compréhension de ces idées. Pendant que j'écrivais un ouvrage sur la Révolution, les premiers signes, les premiers pressentiments de mon système surgirent en moi, comme une sorte de récompense. Ainsi donc, ce système appartient déjà dans une certaine mesure à la nation française. " (13)Avec le même enthousiasme Hegel (1770-1831) rappelle, à la veille de sa mort (alors qu'il avait 19 ans en 1789) la grande espérance de sa jeunesse lorsqu'éclate la Révolution française:
" La pensée, le concept du droit se fit tout d'un coup valoir, et le vieil édifice d'iniquité ne put lui résister [É] Depuis que le soleil se trouve au firmament [É] on n'avait pas vu l'homme [É] se fonder sur une idée et construire d'après elle la réalité (..). C'est donc là un superbe lever de soleil. Tous les êtres pensants ont célébré cette époque. Une émotion sublime a régné en ce temps-là, l'enthousiasme de l'esprit a fait frissonner le monde, comme si à ce moment seulement on en était arrivé à la véritable réconciliation du divin avec le monde. " (Leçons sur la philosophie de l'histoire. p. 401)Telle fut la source historique d'une philosophie moderne de l'acte, dont Marx disait : "C'est la théorie allemande de la Révolution Française."
De sa propre philosophie de l'acte dont il a donné la formule la plus notoire dans sa Onzième thèse sur Feuerbach, en 1844: " Les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde, maintenant il importe de le changer," il a puisé la source d'abord dans la philosophie de Fichte.
L'idée maîtresse du système de Fichte est celle de l'homme créateur, l'idée que l'homme est ce qu'il se fait. Pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, se trouvait mis en cause le primat de l'essence, d'une définition à priori, au profit de la libre activité créatrice. Pour la première fois une philosophie de l'acte s'opposait radicalement à une philosophie de l'être.
Exister, pour lui, c'est agir, c'est créer. Cet action, cette création, déborde constamment ce qui est déjà créé et soumis aux lois de la connaissance, qui est réflexion seconde par rapport à l'action et à la création première de l`homme. Elle n'annule pas pour autant cette oeuvre antérieure ; elle constitue l'ensemble des conditions qui s'imposent à l'action et lui résistent, tout comme elle constitue une essence de l'homme, non pas a priori, ni même figée, mais en devenir, en enrichissement constant... La pensée de Fichte, donnant consistance et réalité à la trace traditionnelle que la création humaine laisse dans son sillage, a découvert, au moins sous une forme abstraite, ce qui deviendra, en se concrétisant dans la pratique sociale et historique, le principe même du matérialisme historique : " Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé." (14)
L'existence n'est pas un donné, ni au sens d'une nature, comme l'entendaient les empiristes et les matérialistes, ni au sens d'une essence, comme l'entendaient le rationalisme dogmatique et la dialectique prémarxiste.
Parce que l'existence est de l'ordre du faire, de la création, il y a une histoire, une émergence du nouveau.
Ni le Moi dont il part, ni celui auquel il aboutit, ne peuvent être confondus avec le Moi de l'individualisme égoïste.
Le Moi dont part Fichte n'est pas celui de l'individualisme car il n'est pas une donnée, mais un acte : le sujet agissant qui porte en lui, virtuellement, la loi de la raison.
Le Moi, qui est le terme idéal du système, c'est le sujet qui a pleinement réalisé, en lui et hors de lui (dans la nature et dans la société) un monde entièrement transparent à la raison, et qui a donc cessé d'être un individu particulier.
Au principe comme au terme, le Moi de Fichte, loin de s'isoler dans sa particularité sensible et de s'y complaire, est exigence de réalisation de l'universel. Il est l'acte de prendre part à l'histoire universelle. Ce Moi est d'abord virtuellement habité par toute l'humanité. Il est la synthèse de toute l'humanité, non seulement de sa culture passée, mais de ce qu'elle est appelée à devenir dans la totalité de son histoire C'est, disait Fichte, " la communion des saints ". Ce qui est caractéristique de la conception du moi, chez Fichte, c'est son perpétuel dépassement. En chaque moment le Moi pose sa limite, et, en même temps, la franchit, comme si l'infini l'appelait: son présent ne se définit jamais qu'en fonction de son avenir en naissance. Le Moi est toujours projet : ce que j'ai été et ce que je suis ne prend tout son sens que par ce que je serai. L'existence n'est donc jamais un donné mais une création. Elle est toujours en train de se faire. C'est là le principe premier d'une philosophie de l'acte.
La pratique, en définitive, chez Fichte, en dépit de son vocabulaire kantien et de son idéalisme, c'est l'engagement de l'homme tout entier dans un effort collectif pour faire l'histoire, pour transformer la nature et construire la société.
" L'homme qui s'isole, écrit Fichte, renonce à sa destinée ; il se désintéresse du progrès moral. Moralement parlant ne penser qu'à soi, ce n'est même pas penser à soi, car la fin absolue de l'individu n'est pas en lui-même ; elle est dans l'humanité entière. On ne satisfait pas au devoir, comme on est trop souvent porté à le croire et comme on s'en fait un mérite, en se confinant dans les hauteurs de l'abstraction et de la spéculation pures, en menant une vie d'anachorète ; on y satisfait non par des rêves, mais par des actes, par des actes accomplis dans la société et pour elle. " (Fichte, Sittenlehre, IV.§ 18)Sans doute, en disciple de la Révolution française, il demeure prisonnier d'une conception historique bourgeoise de la propriété et il lui donne un statut métaphysique: la propriété est le champ nécessaire à l'exercice de la liberté et la matière nécessaire de l'action ; mais, emporté par le mouvement même de l'histoire qui vient de mettre radicalement en cause la propriété sous sa forme féodale, il refuse d'identifier la propriété avec la possession de richesses données. Ici encore, selon l'esprit qui inspire toute sa philosophie, à la chose il oppose l'acte. Le travail demeure la substance de la propriété: selon la théorie fichtéenne du droit, seul peut m'appartenir légitimement ce à quoi s'applique ma liberté.
Il n'en reste pas moins que Fichte, en fonction même de sa théorie de l'Etat et du contrat, et malgré l'étendue des pouvoirs qu'il reconnaît à l'Etat, considère que tout homme acculé à la misère ou à la faim est, par là même, libéré de tout devoir social. Fichte dépasse ainsi la conception d'une liberté formelle et tend vers la revendication d'un droit réel.
Mais prisonnier, comme la Révolution française elle-même, de la confusion entre la liberté du marché et la liberté humaine, par laquelle ce libéralisme peut se réaliser aussi bien dans une démocratie (ouvertement ou hypocritement censitaire) que dans une dictature bonapartiste, à l'heure où s'annonce, avec la chute de Napoléon, la restauration de l'autocratie prussienne, le titan prométhéen de la Doctrine de la science se transforme en sujet docile proclamant que la philosophie "reconnaît que toute chose est nécessaire et bonne et nous réconcilie avec tout ce qui existe, tel qu'il existe, car il doit être ainsi en fonction des fins dernières. " (Fichte. Les Traits caractéristiques de notre époque.)
* * * Le parcours philosophique de Hegel est de même nature que celui de Fichte. Lui aussi a vécu l'écroulement d'un monde, la naissance d'un autre et son avortement politique. Il a 19 ans à la prise de la Bastille, 24 en Thermidor, 29 au 18-Brumaire. Il est en train d'achever sa Phénoménologie de l'Esprit lorsqu'en 1807 les troupes françaises d'invasion bivouaquent à Iéna devant sa maison, et lorsque la Paix de Tilsit consacre l'écroulement de sa patrie, la Prusse.
Il écrit sa Science de la logique, de 1812 à 1816, c'est à dire entre le moment où commence, en 18I3, le soulèvement national de son pays contre l'Empire napoléonien et l'écroulement de Waterloo.
L'année où il publie sa Philosophie du droit, 1821, est celle du Congrès de la Sainte-Alliance, à Laybach.
Ses cours sur les Leçons sur la Philosophie de l'histoire, il les professe de 1822 à 183I, au milieu des plus grands bouleversements de l'histoire : il les commence au moment où la Grèce, en 1822, proclarne à Epidaure son Indépendance. Le trône d'Espagne est renversé, et l'Amérique latine brise le joug colonial de l'Espagne ; en 1825 éclate, à Saint-Pétersbourg, I'insurrection des Décabristes.
L'oeuvre grandiose de Hegel n'est pleinement comprise que dans les lueurs de cette Apocalypse.
Dans ce contexte seul est intelligible la tentative hégélienne de synthèse entre l'universel et l'individu, entre le logos des Grecs et le moment chrétien de la subjectivité.
Lorsque Hegel, à vingt ans, vit dans la Révolution française la réponse aux problèmes posés par la situation de l'Allemagne, il crut découvrir le modèle de la liberté la plus parfaite, de l'harmonie entre l'individu et la société et, par conséquent, de l'harmonie intérieure de l'individu entre sa raison et ses passions, comme, pensait-il, dans la Cité et la religion des Grecs.
Mais le développement même de la Révolution française et les résistances auxquelles elle se heurte, en France et, plus encore, en Allemagne, l'antagonisme de plus en plus évident entre l'idéal de la volonté générale et les intérêts privés, leurs coalitions et leurs rébellions, sont une expérience qui conduit Hegel à rechercher les sources historiques de cette affirmation de l'individu, de la particularité, contre le tout. L'étude de la désagrégation de la cité antique, de la naissance du christianisme et de son évolution, l'amène à une conception plus complexe et plus riche de la liberté. A la participation active de l'homme à sa cité terrestre, s'ajoute une exigence nouvelle: celle de l'irréductible subjectivité de l'homme. Le problème de Hegel devient plus complexe. Le problème de la liberté se pose désormais dans des termes neufs: comment retrouver l'immanence vivante de la totalité sociale dans l'homme en intégrant le moment de la séparation, le moment de la subjectivité ? La liberté se définit toujours par la participation au tout, mais à travers la conscience de soi.
Avec le christianisme, la conscience a connu un double déchirement : l'opposition de deux mondes, celui de l'au-delà et celui de l'en deçà, et la même opposition transposée à l'intérieur de l'homme. L'univers chrétien est celui de la conscience malheureuse.
Hegel ne voit pas là un accident de l'histoire mais une loi nécessaire du développement: désormais, pour atteindre le bonheur, il faut traverser le malheur. C'est un thème central de l'oeuvre de Hölderlin et de Goethe.
C'est aussi l'idée maitresse de la philosophie de l'histoire de Hegel. L'histoire, pour lui, c'est l'avènement de la liberté. Mais le progrès n'est pas linéaire. Dans l'Introduction à ses Leçons sur la Philosophie de l'histoire dans lesquelles son système idéaliste atteint son plein épanouissement, Hegel donnera la formule la plus nette du caractère contradictoire, dialectique, de ce progrès.
Hegel s'efforce de surmonter le pessimisme, en substituant à l'idée trop simple du progrès telle que l'avait élaborée la philosophie des lumières (Condorcet par exemple), une conception du progrès de la liberté intégrant le moment de la séparation, de la destruction de l'unité, de la conscience de soi, qui est une conscience malheureuse.
Hegel a tenté de réaliser la synthèse de l'hellénisme et du christianisme. De l'hellénisme où l'homme, dans l'unité vivante de la cité, n'a pas pris conscience de son malheur, et du christianisme où l'homme, parvenu à la conscience de soi la plus aiguë, au déchirement et au désespoir, n'a pas pris conscience de son bonheur.
Le destin est le mode d'existence de la totalité dans l'individu, de la particularité dans l'absolu. L'immanence de l'infini dans le fini est l'un des thèmes centraux du système hégélien.
Aux environs de 1800, la perspective historique devient, pour Hegel, obscure. Le grand rêve hellénique, après la Terreur, s'est éloigné comme un mirage : il n'apparait plus possible à Hegel que la totalité sociale soit directement présente et agissante dans chaque individu comme elle le fut, croyait-il, pour le citoyen libre de la Cité antique. Ou bien la totalité liquide la particularité, comme ce fut, à ses yeux, le cas pour la Terreur, ou bien le réseau des intérêts privés s'intercale entre l'individu et l'Etat, donnant à la société civile, à l'entrelacs des appétits et des convoitises économiques affrontés, la domination réelle sur les individus et sur l'Etat, comme en témoignaient les corruptions des affairistes du Directoire.
Le Consulat et le régime napoléonien constitueront, pour Hegel, la solution de ce problème : l'Etat prenant en main les grands intérêts économiques et imposant un ordre au chaos des concurrences.
Hegel a décidé de se réconcilier avec le monde réel, hurler avec les loups (Lettre du 9 février 1797. I, 49.)
Son affirmation de la souveraineté de l'homme l'avait jusque-là conduit à distinguer dans l'histoire trois étapes fondarnentales :
-- celle de la cité antique, de ces libres républiques où le citoyen se réalisait pleinement dans sa patrie ;
-- celle du christianisme, d'une période de servitude où l'individu se replie sur lui-même et conçoit la nature et la société comme des puissances étrangères (aliénées);
-- celle de la Révolution française qui permet une réappropriation de la liberté concrète du citoyen antique en sauvant la particularité de chaque individu.
Maintenant, après l'expérience thermidorienne, le Directoire, les guerres de conquêtes du Consulat, le maintien du statu quo social en Allemagne, Hegel éprouve douloureusement les contradictions de son époque, il n'est plus question d'une transformation révolutionnaire de ce monde.
De là découle la contradiction centrale de l'oeuvre de Hegel : une exaltation théorique de la Révolution française, qui se transforme, en pratique, en une justification de la monarchie prussienne.
Les sinuosités tragiques de cette vie ne sauraient nous faire oublier la grandeur de l'oeuvre : dans ses Manuscrits de 1844, Marx est allé d'emblée, dans la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, à l'essentiel, à l'idée centrale des chapitres du maître et de l'esclave, et de la culture :
" La grandeur de la "phénoménologie" de Hegel et de son résultat final -- la dialectique de la négativité comme principe moteur et créateur -- consiste d'une part en ceci, que Hegel saisit la production de l'homme par lui-même comme un processus... comme aliénation et suppression de cette aliénation -- il saisit l'essence du travail, et conçoit l'homme... comme le résultat de son propre travail. "
Il est remarquable que ce que Marx apprécie le plus chez Hegel, c'est précisément le moment fichtéen de sa pensée : la philosophie de l'acte par opposition à la philosophie de l'être.
L'histoire tout entière est cette création continue de l'homme par l'homme dans son développement dialectique. Avec " la négation de la négation.... Hegel a trouvé l'expression abstraite, logique, spéculative, du mouvement de l'histoire."
Cette découverte capitale de Hegel ne saurait faire oublier ses limites.
Marx nous dit que " Hegel se place du point de vue de l'économie moderne " (c'est à dire de l'économie bourgeoise, notamment d'Adam Smith et de Ricardo). Il dit aussi (ce qui est la même idée sous une autre forme) : " Le philosophe lui-même, -- forme abstraite de l'homme aliéné -- se donne pour la mesure du monde aliéné ". Et encore: " L'économie politique n'a exprimé que les lois du travail aliéné. "
Si bien qu'il croit que l'histoire a atteint son but lorsque cette économie industrielle et marchande aura triomphé. Alors il pourra s'écrier comme le Faust de Goethe, devant le même triomphe : " Arrête-toi, instant, tu es si beau !"
Marx dit plaisamment : avec le système de Hegel, on a l'impression " qu'il y a eu de l'histoire mais qu'il n y en aura plus. "
Et pourtant la dialectique hégélienne était porteuse du mouvement qu'il est arbitraire d'arrêter.
Lénine estimait que l'on ne peut parfaitement comprendre le Capital de Marx, et en particulier le livre premier, sans avoir assimilé complètement la logique de Hegel. Engels donnait, dans une lettre à Conrad Schmidt du 1er novembre 1891, cette précision supplémentaire: "Comparez le développement de la marchandise au capital chez Marx, avec le développement de l'être à l'essence chez Hegel, et vous aurez un parallélisme saisissant. "
En effet, la dialectique de Hegel est d'abord une logique de la relation : elle installe toute réalité au coeur de la totalité organique et vivante des choses.
Pour Hegel, le monde est une totalité et la vérité est la reconstruction de ce TOUT à partir duquel chaque être particulier trouve sa réalité et son sens.
La dialectique est une logique du mouvement. Dans ce monde peuplé de forces affrontées, le mouvement est un corollaire de l'universelle interdépendance. Si tout se tient, tout se meut. Le repos est une abstraction : c'est un faux problème de se demander comment des êtres primitivment immuables ont été mis en mouvement. Le vrai problème est d'expliquer, à partir de la réalité du mouvement, l'apparence du repos, qui est un équilibre plus ou moins stable.
La dialectique est une logique de la vie. Elle est l'ensemble mouvant des rapports internes d'une totalité organique en devenir.
La finalité des choses, c'est précisément ce mouvement qu'elles portent en elles, cette tendance, née de la contradiction entre leur nature finie, et qui les porte, au-delà d'elles-mêmes, vers l'infini.
Chez Hegel, contradiction et totalité s'opposent et s'impliquent comme le fini et l'infini: ce qui est la totalité du point de vue de l'infini est contradiction du point de vue du fini. La totalité est vécue comme contradiction par l'être fini. Ou encore : la contradiction est la catégorie centrale de la méthode hégélienne, la totalité est la catégorie centrale du système hégélien.
En chaque moment la totalité appelle à elle tout le devenir : sa présence, agissante dès le départ, est présente en chaque être particulier comme son tourment : son insuffisance comme être fini est le moteur du développement. Mais cette insuffisance n'existe que par référence à la totalité. Hegel dit d'ailleurs sans équivoque : "En allant au fond des choses, on trouve tout le développement inclu dans le germe" (15). La totalité préexiste donc aux moments du devenir et les fonde : la contradiction n'est que la petite monnaie de la totalité.
Cette conception hégélienne de la totalité implique donc :
1. L'existence d'un monde et d'une histoire achevés;
2. La connaissance de cet achèvement sans quoi la circularité nécessaire au savoir absolu n'est pas réalisée.
Du poème d'Héraclite à la Phénoménologie de l'Esprit et à la Logique de Hegel, la pensée et le réel sont saisis, dans leur unité vivante, comme une totalité organique en devenir constant, avec leurs contradictions, chaque forme préparant la suivante en un cycle incessant de naissance, de développement et de mort.
Chez Hegel, la pensée part de principes immuables. Elle aboutit à une totalite achevée. C'est ce qu'il reste de théologique dans son système, en contradiction avec sa méthode.
Hegel avait porté à son achèvement le plus parfait la philosophie de l'être : celle qui, depuis Socrate, réduit l'être au concept, et la morale à la logique.
Marx disait avec raison que Hegel était la " fin de la philosophie". Du moins de la philosophie de l'être.
Ceux qui prétendirent continuer dans cette voie, après la grandiose synthèse hégélienne, n'eurent plus aucune prise sur l'histoire, chacun exploitant ce qui n'était qu'un moment de la philosophie de Hegel. L'on pourrait dire d'eux comme Ruy Blas des successeurs de Charles Quint :
"... Un tas de nains difformes Se taillent des pourpoints dans son manteau de roi."
* * * Un monde sans l'homme : Auguste Comte et le positivisme.
L'acte de décès de la philosophie, dont la vocation était la recherche du sens et des fins de la pensée et de l'action de l'homme, a été signé par Auguste Comte (1798-1857)
Ce qui permet de comprendre l'unité de son oeuvre, c'est sa préoccupation principale : la Révolution française a mis fin à l'ordre féodal et théocratique: c'est un progrès. Elle a institué un ordre nouveau, fondé sur la science, la technique, l'industrie, qui est la fin de l'histoire. Il ne doit plus être mis en cause par une nouvelle révolution comme celle de 1848. C'est à cette date que Comte lance son slogan : ordre et progrès.
La Révolution française a inauguré l'âge de la raison industrielle. C'est en quoi consiste le progrès. L'ordre consiste à le maintenir. Auguste Comte n'hésite donc pas, dans son Appel aux conservateurs, à s'adresser au Tsar de Russie et au grand Vizir ottoman, pour faire obstacle à toute nouvelle révolution et maintenir l'ordre établi.
Dès 1822, il publie un ouvrage : Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société qui contient, en germe, son système futur exposé en trois livres principaux : Le cours de philosophie positive (1830-48), le Système de politique positive (1851-1854), et, plus concis, le Catéchisme positiviste (1852), centrés, le premier sur la science, le second sur la politique, le troisième sur une religion nouvelle fondée sur les deux premiers
La science est celle de son temps : mécanique et déterministe ; celle que Laplace ((1799 -- 1827), l'un des fondateurs de l'Ecole Polytechnique (dont Auguste Comte incarnera pour longtemps l'esprit), a réalisé, en son livre : L'exposition du système du monde , (1796), réédité en 1824, synthèse de l'ensemble des connaissances physiques dominée par la définition la plus rigoureuse du déterminisme mécanique:
"Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome; rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. " (Essai philosophique sur les probabilités, publié en 1812)L'exclusion de toute cause finale au niveau de la physique, Auguste Comte en fait une loi universelle, appliquant à l'homme lui-même et aux sciences qui le concernent, telles que l'économie politique et la sociologie, (qu'il appelle aussi : physique sociale), les mêmes méthodes, c'est à dire le même déterminisme mécanique, excluant, par principe, toute question sur le sens.
Ainsi dans sa loi des trois états : l'état théologique est récusé parce qu'il pose la question du pourquoi ? et ne se contente pas du comment ? Cet âge théologique s'étend, selon lui, des origines de l'humanité jusqu'au XIIIe siècle, ignorant totalement toutes les sagesses non-occidentales. (Il fondera significativement une Revue occidentale).
L'âge métaphysique ne constitue qu'une transition, traduction abstraite de la vision théologique.
L'âge positif est celui où l'homme se borne à observer ce qui est et à en établir les lois : " La connaissance par les causes est remplacée par le déterminisme des lois. "
Il n'y a donc plus place, dans cette philosophie de l'histoire, que pour une extrapolation quantitative du présent pour prévoir l'avenir. Auguste Comte est ainsi le père de ce scientisme totalitaire de la prospective technocratique et, finalement, de l'ordinanthrope qui croit que la science (contenue dans l'ordinateur) peut répondre à toutes les questions, non pas seulement sur les moyens mais sur les fins, depuis que Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique, a considéré que les sociétés humaines étaient désormais trop complexes pour être gérées par les hommes et qu'il fallait donc s'en remettre à la machine pour le faire à sa place, excluant toute décision de l'homme : il serait déraisonnable de vouloir changer le cours de l'histoire.
Il s'agit au contraire, une fois de plus, de tenter de l'arrêter. En enfermant la connaissance dans le donné, il enferme l'action dans l'ordre établi.
C'est le fondement de tout conservatisme, comme l'avait fort bien vu Charles Maurras.
D'autant plus que ce système dogmatique, sera cloîtré, par Auguste Comte, dans une religion.
Dans son Catéchisme du positivisme il crée une sorte de catholicisme sans Dieu, en transposant, pour son église positiviste, tout le système hiérarchique, rituel et dogmatique, de l'église catholique de son temps.
Auguste Comte a ainsi pu célébrer, de la philosophie de l'être, à la fois le couronnement et les funérailles.
* * * La troisième sécession de l'Occident, après cinq siècles de colonisation, et 2 guerres civiles européennes (de 1914-1918 et de 1940-1945) est celle de la mondialisation, c'est à dire de l'occidentilisation du monde sous direction d'une Amérique qui, réussit, du point de vue économique, à amasser, en 1945, la moitié de la richesse mondiale, aux dépens d'une Europe exsangue de l'Atlantique à l'Oural et d'un Tiers-Monde affamé.
Du point de vue politique, ce pays, qui avait consenti le minimum de pertes humaines, se voulut le maître du monde, dictant sa loi à l'Europe mendiante du Plan Marshall qui rouvrait à l'Amérique un marché européen ruiné par la guerre, imposant à Bretton-Woods un règne du dollar égal à celui de l'or, et, cinquante ans après, un traité de Maestricht où il est dit expréssement que "l'Europe ne pourra être" que "le pilier européen de l'Alliance Atlantique" (c'est-à-dire, en clair, une Europe, soumise aux lois américaines comme l'ont illustré les lois de Helms-Burton et les lois d'Amato, légiférant pour le monde entier en imposant ses embargos).
Le XXème siècle est né avec quelques années de retard : avec l'incendie de 1914, cette guerre d'où ne sortirent que des vaincus. Ce qui précède, les quelques années ou l'on dansait encore sur les volcans éteints de la ligne bleue des Vosges et de la Commune de Paris. Celle-ci avait éveillé les espérances messianiques de ceux qui n'ont pas et les sauvages terreurs de ceux qui ont. Elles n'en font pas partie.
Il n'y avait plus que des ruines, des monuments aux morts, et la conscience de l'effondrement de toutes les valeurs.
Sur les deux rives du Rhin la vie sociale marquait un recul historique d'un siècle : d'un côté avec une Chambre bleu horizon face à la colère des grèves de 1920, de l'autre avec la répression sauvage de Spartacus et de ceux qui en incarnaient les rêves : Liebnecht et Rosa Luxembourg.
Au delà des ténèbres se levait alors un nouveau matin, avec ses nouvelles espérances messianiques, aussi bien pour les peuples brisant le joug des anciens tyrans, que pour les artistes, les poètes, savants, les Anatole France comme les Aragon, les Langevin comme les Romain Rolland, qui saluaient l'aurore. En face la grande terreur des maîtres qui essayaient d'endiguer ce déferlement d'avenir, par une politique du fil de fer barbelé avec Clémenceau, ou le projet de Churchil de marcher sur Moscou en battant le rappel de tous les débris du passé pour empêcher de naître autre chose que ce qui est.
Le siècle entier allait être dominé par cette grande peur et cette promesse d'un monde autre. Par l'irrésistible ascension aussi du désespoir et de la fureur des vaincus : le traité de Versailles portait en lui le germe d'une nouvelle tuerie que seul Lord Keynes annonçait prophétiquement dans son livre : Les Conséquences économiques de la paix (1922) : "Si nous cherchons délibérément à appauvrir l'Europe centrale j'ose prédire que la vengeance sera terrible : d'ici vingt ans nous aurons une guerre qui, quel que soit le vainqueur, détruira la civilisation."
En exigeant de l'Allemagne, sous prétexte de réparations, la moitié de sa richesse, fut préparé le naufrage de tout un peuple : le désespoir et l'humiliation des coeurs, le torrent des faillites, et le chômage des multitudes. Les provocations des vainqueurs suscitèrent l'appétit de vengeance et le déchaînement du Tout plutôt que cela, qui assura le triomphe de la démagogie nationaliste la plus délirante, le désir à tout prix de sortir de la misère et du chômage. Il ne fallut que 16 ans de fermentation de ce bouillon de culture, pour assurer le triomphe de l'homme providentiel. Il accéda au pouvoir de la façon la plus démocratique du monde, obtenant, avec ses alliés, la majorité absolue au Parlement de la République de Weimar.
Nous avons montré, dans un autre livre (16), le parallélisme rigoureux entre la courbe de la montée du chômage et celle de la montée du National-Socialisme.
Hitler trancha le noeud gordien en transformant les chômeurs en ouvriers des usines d'armement, puis ceux-ci en soldats, et ces soldats en cadavres. Le problème était résolu.
Les conditions étaient remplies pour que la deuxième guerre mondiale ne soit que la suite de la première : conséquence de l'aveuglement des vainqueurs, et de l'ivresse qui s'était emparée d'eux pour avoir abattu le grand rival économique et politique de l'Angleterre et de la France.
a) -- Les Etats-Unis, avant-garde de la décadence
Deux éléments nouveaux allaient alimenter le brasier et rendre plus redoutable encore la conflagration inévitable.
A l'Ouest était née une puissance nouvelle, celle des Etats-Unis, pour qui la guerre de 1914-1918 fut une affaire économique sans précédent au point d'en faire désormais une grande puissance.
Les Etats-Unis, était le seul pays au monde qui, depuis sa fondation, n'avait jamais connu d'occupation étrangère sur son sol, et s'était enrichi de toutes les misères du monde : de l'expulsion et du massacre des indiens à l'exploitation de la main d'oeuvre des esclaves noirs, à la relève de l'Angleterre en Amérique du Sud et de l'Espagne dans les îles. Les pertes de l'Europe au cours de la guerre de 1914-1918 avaient fait couler un pactole d'or de l'autre côté de l'Atlantique : par ses ventes et ses prêts l'Amérique était devenue désomais une puissance de premier plan. Il ne lui restait plus qu'à voler au secours de la victoire en débarquant en 1917, après Verdun, comme elle volera au secours de la victoire, une deuxième fois, en 1944, après Stalingrad. Elle était sûre ainsi d'appartenir, aux moindres frais, au camp des vainqueurs, et de régner sur une Europe exsangue, de l'Atlantique à Moscou, sa nudité revêtue de cadavres et de ruines, avec cinquante millions de morts.
L'autre acteur nouveau était à l'Est. L'URSS supportait, en 1944, le poids de 236 divisions des nazis et de leurs satellites alors que 19 seulement s'opposaient en Italie aux troupes américaines, et que 65 étaient réparties de la France à la Norvège.
Depuis l'accession d'Hitler au pouvoir, les EtatsUnis, l'Angleterre et la France, voyant en lui, comme le disaient les évêques allemands "le meilleur rempart contre le bolchevisme", lui avaient fourni les crédits et les armes (la France lui fournit du fer pour ses canons jusqu'en 1938, l'Angleterre négocia avec lui des crédits jusqu'en 1939, et les Etats-Unis maintinrent leur ambassadeur à Vichy).
En outre l'on avait cédé à toutes ses exigences : lui laissant, sans coup férir, s'emparer de la Bohème et dépecer la Tchécoslovaquie, réaliser l'Anschluss (l'annexion de l'Autriche), participer en Espagne à une non intervention lui permettant d'intervenir, avec son complice Mussolini et ses propres légions Condor, jusqu'aux frontières sud de la France, à Guernica.
Le symbole de tous ces abandons, celui de Munich, lui livrait l'équivalent tchèque de la Ligne Maginot, avec l'espoir évident de détourner les appétits de l'ogre vers l'Est et l'Union Soviétique. Les munichois, épaulés par la dictature polonaise interdisant à l'URSS de faire passer ses troupes sur son territoire pour affronter Hitler avant qu'il n'arrive aux frontières russes dès l'invasion de la Pologne, il ne restait plus à Staline, pour éviter de supporter tout le poids d'une inévitable poussée hitlérienne, qu'à gagner du temps par un pacte de non agression, symétrique de celui de Munich, pour se préparer à une guerre alors inévitable.
Hitler réussissait ainsi à n'avoir pas à se battre sur deux fronts et pouvait dévorer l'Occident avant de se ruer vers l'Est soviétique.
Quant aux Etats-Unis, le sénateur Truman (devenu quelques années plus tard le Président Truman) définissait parfaitement la ligne constante de la politique americaine : "Si l'Union Soviétique faiblit, il faudra l'aider; si l'Allemagne faiblit, il faudra l'aider. L'essentiel est qu'ils se détruisent l'un l'autre."
Il est significatif que pour avoir lu cette déclaration de Truman à Radio-France, à Alger, où j'étais devenu, après ma libération des camps de concentration, rédacteur en chef du journal parlé du matin, je fus chassé de mes fonctions par ordre du représentant américain Murphy, malgré l'approbation de mon texte par le Général de Gaulle. (Voir Tome I de Mon tour du siècle en solitaire.)
Les voeux de Truman furent réalisés de sorte qu'au sortir de cette deuxième guerre en Europe, beaucoup plus ravageuse que la première, le Plan Marshall permit à l'économie américaine de poursuivre son ascension, en faisant de l'Europe ruinée un client de nouveau solvable.
Ainsi le troisième tiers du siècle fut dominé par une guerre froide entre les richissimes Etats-unis et une Union Soviétique qui avait, à Stalingrad, brisé l'armée allemande et avait poursuivi l'ennemi jusqu'à Berlin où Hitler dut se suicider dans son bunker de la Porte de Brandenbourg. Après la véritable déclaration de guerre de Winston Churchill, dans son discours de Fulton, et son aveu qu'on avait "tué le mauvais cochon", c'est à dire l'Allemagne hitlérienne au lieu de l'URSS et de Staline, la course aux armements entre les Etats-unis se poursuivit dans l'espace, les succès de l'un, comme celle du premier Cosmonaute (Gagarine), entrainaient la surenchère du rival jusqu'au paroxysme de la guerre des étoiles imaginée par Reagan.
L'URSS s'était épuisée en supportant l'essentiel du poids de la guerre contre Hitler : ses terres les plus fertiles de l'Ukraine avaient été ravagées par l'envahisseur, et les centres industriels les plus décisifs avaient été détruits. Elle était inéluctablement dépassée par les Etats-Unis qui avaient au contraire tiré du carnage européen le plus grand profit.
Pour soutenir un tel effort les dirigeants soviétiques adoptèrent le modèle de croissance de l'Occident, reniant ainsi toutes les promesses du socialisme. Ils en moururent par implosion du système.
Je rencontrai Gorbatchev longtemps après qu'il eut déclenché l'avalanche. Précipitée par la prostitution politique d'Eltsine à ses conseillers américains (tels que Soros), la restauration du capitalisme en URSS porta ses fruits habituels : l'accumulation de la richesse à un pôle de la société et de la misère à l'autre. L'on vit naître, avec la vitesse de champignons vénéneux, des fortunes maffieuses qui firent de Moscou un marché alléchant pour Rolls Royce, et, en même temps, proliférer le chômage, l'exclusion, la mendicité, la délinquance et le crime. L'ancienne Union Soviétique rattrapait l'Amérique sur un point significatif: le trafic de drogues multiplié par 4 en deux ans.
Dans la conversation avec Gorbatchev, je lui dis quel espoir j'avais partagé à la lecture de son livre Perestroika, où apparaît la véritable finalité du socialisme : donner un sens non seulement au travail mais à la vie entière, aliénée par le monothéisme du marché. Un sens nouveau lorsqu'il écrivait par exemple cette parabole résumant l'opposition de l'expérience du travail en régime de marché, c'est à dire de jungle, ou en régime humain, c'est à dire divin : "Un voyageur s'approche d'un groupe de gens en train de bâtir un édifice et demande : Que faites-vous là ?"
L'un d'eux répond avec irritation :
- "Eh bien, tu vois ! Du matin au soir il nous faut transporter ces maudites pierres... ".
Un autre se lève, redresse fièrement les épaules, et dit :
- "Eh bien !, tu vois : nous élevons un temple !". (p. 36-37)
C'est ce que Marx avait profondément distingué : un système social, celui du marché, réduisant l'homme à sa seule dimension animale : le maniement des moyens, ou un système fondé sur ce qu'il y a de proprement humain en l'homme : la conscience des fins précédant l'organisation des moyens et leur donnant un sens. (Le Capital I, XV, 1). L'homme et son travail utilisé comme moyen, sans conscience du but et de la valeur humaine de ce qu'il fait, peut être remplacé,comme force motrice par exemple, par un âne ou par une machine.
L'erreur historique mortelle de Gorbatchev fut précisément de commencer par la réforme des Moyens, c'est à dire de l'économie, en la libéralisant c'est à dire en introduisant ce libéralisme qui est la liberté laissée aux forts de dévorer les faibles. Dès lors cette économie de marché, c'est à dire régulée (ou dérégulée) par les lois non humaines d'un régime où tout s'achète et se vend (depuis la cocaïne jusqu'à la conscience des hommes) selon le profit qu'on en peut attendre, fit, en moins de 3 ans, oeuvre de désintégration de tous les rapports humains. Gorbatchev croyait qu'il allait réformer le socialisme, ce qui survint ce fut la restauration du capitalisme, et du pire : non pas le capitalisme juvénil qui, en dépit de son inhumanité foncière, investissait au moins dans une économie réelle, créatrice d'entreprises, mais le capitalisme déchu, où la spéculation détourne de la production 80 % des capitaux, et où la corruption se substitue à la planification (devenue d'ailleurs sclérosée et irréaliste dans la phase décadente de l'Union Soviétique).
Ce primat accordé à l'économie libérale c'est-à-dire à un monde sans l'homme) désintégra toutes les structures de la société, accentuant les inégalités, cassant tous les rouages de l'Etat au profit de nationalismes parcellaires, d'intérêts monopolistiques étrangers, ou de cupidités individuelles.
C'était méconnaître l'essence même du marxisme de Marx, donnant priorité aux initiatives historiques conscientes de l'homme, au lieu de l'abandonner au déterminisme des lois du marché instituant, dès ses origines, la guerre de tous contre tous sous le nom de liberté confondue avec la concurrence darwinienne des fauves.
Lénine, après Marx, avait bien vu le rôle primordial de la conscience, mais dans la Russie de 1917, où la classe historiquement porteuse de cette conscience n'existait pratiquement pas. Lorsqu'éclata la Révolution d'Octobre 1917, la classe ouvrière représentait en Russie moins de 3 % de la population active. Ainsi fut crée un parti prétendant exprimer la conscience d'une classe qui n'existait pas. De là les glissements ultérieurs : un parti qui se voulait unique (à l'encontre de la pensée constante de Marx depuis la création de la Première Internationale) se donna pour la conscience d'une classe, puis les dirigeants parlèrent au nom de ce Parti, et finalement un seul à la place de la Direction qui avait cessé d'être collégiale et d'exprimer la volonté des communautés de base (soviets).
Bon ou mauvais (mais plus souvent mauvais que bon) ce Parti constituait la colonne vertébrale du pays. Il en était en principe la conscience. C'est à ce niveau de la conscience que pouvait commencer une réforme du système par une véritable révolution culturelle à l'intérieur du Parti. A une étape de l'histoire de l'Union Soviétique (où le niveau de culture de la majeure partie de la population, et les exploits de ses chercheurs et de ses savants qui avaient, en certains domaines, de la médecine à l'exploration spatiale, mis l'URSS à égalité avec les plus grands), l'heure était venue d'une inversion radicale de la conception même du Parti ; toutes les directives ne viendraient plus d'en haut, mais émaneraient au contraire des communautés de base (soviets -- c'est à dire conseils de paysans, d'ouvriers, d'artistes, de savants, de chercheurs en tous domaines), pour que l'initiative de construire un avenir proprement socialiste puise constamment son inspiration dans les expériences de ceux qui sont directement aux prises avec le réel et entendent en contrôler l'évolution.
Cette erreur fondamentale de ne pas commencer par une mutation radical du Parti (et non de l'économie) conduisit à la débacle.
L'Union Soviétique s'est effondrée précisément parce qu'elle n'a tenu aucun compte de la méthode de Marx et s'est contentée de répéter ses formules : Marx avait dégagé les lois de la croissance du capitalisme anglais au XIXème siècle. Les dirigeants et les soi-disant théoriciens soviétiques ont fait une répétition intégriste et dogmatique des théories de Marx en appliquant à l'Union Soviétique, au XXème siècle, les modèles de croissance du capitalisme anglais au XIXème siècle. Son implosion ne signifie nullement une faillite de Marx, mais une faillite de l'interprétation intégriste de Marx qui a conduit à imiter les méthodes de croissance du capitalisme qui reposaient sur l'exploitation des richesses des 3/4 du monde (appelé le Tiers Monde)
L'Union Soviétique est morte pour avoir trahi Marx et pour avoir adopté le modèle de croissance du capitalisme.
Je suis devenu marxiste parce que Marx n'a créé ni une religion, ni une philosophie mais une méthodologie de l'initiative historique nous permettant de dégager les contradictions d'une époque ou d'une société, et, à partir de cette analyse, de découvrir les moyens capables de les surmonter.
Il y eut deux grands analystes du capitalisme : Adam Smith et Karl Marx. Selon Adam Smith, si chaque individu poursuit son intérêt personnel, l'intérêt général sera réalisé, permettant le bonheur de tous.
Karl Marx qui avait profondément étudié Adam Smith, disait qu'en effet le capitalisme libéral créerait de grandes richesses, mais qu'en même temps il créerait une grande misère des masses et une inégalité croissante. Aujourd'hui où, en Amérique, 1% de la population possède 40 % de la richesse nationale et où, dans le monde, 75 % des ressources naturelles se trouvent dans le Tiers-Monde, mais sont contrôlées et consommées par 25 % de la population mondiale, il est facile de savoir qui avait raison : Adam Smith (répété au XXème siècle par les prétendus libéraux, comme Friedman aux Etats-Unis ou un Raymond Barre (son traducteur en France), ou bien Karl Marx ? La réponse est claire, c'est Karl Marx, et c'est pourquoi je suis resté marxiste car on ne peut rien comprendre à la situation actuelle du monde et à ses inégalités croissantes sans utiliser les méthodes de Marx et non pas celles d'Adam Smith, de Friedman ou de Von Hayek.
Le XXe siècle n'est donc pas la faillite du socialisme de Marx, mais la faillite du modèle de croissance qui a créé de telles inégalités que quarante-cinq millions d'êtres humains (dont treize millions et demi d'enfants -- selon les statistiques de l'UNICEF) meurent chaque année de faim ou de malnutrition. C'est dire que le système actuel de croissance des pays occidentaux (sous la direction des Etats-Unis) coûte au monde l'équivalent de morts d'un Hiroshima tous les deux jours. Quarante fois, chaque année, ce qu'a couté Auschwitz par an.
Je répète : un Hiroshima tous les deux jours. Quarante Auschwitz par an.
On ne saurait imaginer une gestion plus désastreuse de la planète sous la domination du pire ennemi de l'humanité : les dirigeants américains, de Reagan à Clinton, qui sont, avec leurs mercenaires israéliens et anglais, les pires terroristes du monde. Alors que, dans un langage commun à Hitler, à Clinton et à Netanyahou, l'on appelle terroristes les résistants à une occupation étrangère.
L'inversion du rêve inital de Marx et des militants d'Octobre 1917, découlaient de conditions objectives (comme autrefois la dégénérescence de l'idéal des Lumières et de 1789, en Terreur jacobine, en pourrissement du Directoire et finalement en dictature napoléoniènne La France en sortit moralement désorientée par la Restauration avec ses régressions sociales, ses inégalités aggravées (comme la Russie d'aujourd'hui après la Restauration du capitalisme.)
Les principales dérives venaient d'abord d'une interférence constante entre les problèmes de la construction du socialisme et ceux du développement, du fait que le socialisme ne succédait pas à un capitalisme pleinement développé comme l'avait conçu Marx, mais d'un capitalisme retardataire, celui de la Russie. L'intervention extérieure et l'Etat de siège des pays capitalistes rendit la situation plus complexe encore.
Winston Churchill se flattera, dans son livre : The World Crisis (Londres 1929) d'avoir organisé contre la République des Soviets, "une croisade de 14 Etats ".
Le chiffre 14 évoque celui des 14 armées que l'Europe fit converger, en 1792, sous les ordres du Duc de Brunschwig, pour écraser Paris et la Révolution française. En France, Clémenceau déclare qu'il faut pratiquer à l'égard de la Russie rouge : "une politique du fil de fer barbelé".
Churchill, plus offensif encore, ajoute : "établir un cordon sanitaire et foncer sur Moscou."
Ce boycott affamera (Les affamés de la Volga auxquels Anatole France envoyait son Prix Nobel) le peuple russe. Enfin, résister à l'encerclement, au surarmement, et à la menace permanente de l'environnement haineux des dirigeants des pays Nantis, exigea une politique d'armement à outrance : Staline disait, en 1930, au XVI ème Congrès du Parti bolchevik : "Il nous faut 17 millions de tonnes d'acier.... nous devons combler ce retard en 10 ans ou ils nous écraseront."
Cet objectif fut atteint en 1941, à un coût humain effroyable pour le peuple soviétique. Mais, s'il ne l'eût pas été, qui aurait brisé l'armée nazie à Stalingrad ?
Il est vrai que cette politique féroce conduisit à une militarisation qui amena l'économie au chaos et les hommes au cachot.
L'ensemble de ces contradictions internes et des théorisations intégristes des dirigeants conduisit à l'implosion du système.
* * * La première guerre, épuisant l'Europe, a fait des Etats-Unis une grande puissance économique.
La deuxième guerre mondiale fut la plus belle affaire des Etats-Unis : fournisseur de l'Europe, puis, dans une Europe une nouvelle fois exsangue, extraordinaire prêteur et investisseur, son potentiel économique a augmenté de 40 % grâce à cette deuxième guerre mondiale, et de 7 % encore avec la guerre de Corée.
Vertigineuse tentation, aujourd'hui, lorsqu'à la fois s'effondrent, à l'Est, les possibilités de résistance, et que les anciennes puissances coloniales autrefois rivales, l'Angleterre et la France, -- du moins leurs dirigeants -- se résignent aux rôles de supplétifs de l'armée américaine dans des entreprises n'opposant plus désormais l'Est et l'Ouest mais le Nord et le Sud.
Ainsi semble s'ouvrir l'ère d'un déchirement nouveau de la planète entre un Occident coalisé, du Pacifique à l'Oural, pour perpétuer l'hégémonie du Nord contre le Sud.
La guerre du Golfe fut le prélude annonciateur de ce danger de guerre des mondes. Le dévoilement progressif des objectifs de guerre des Etats-Unis est révélateur : invoquant d'abord, la défense du droit international, invariablement oubliée jùsque là pour toute invasion, il n'a pu échapper qu'aux naïfs, trompés par les médias, qu'il s'agissait d'une guerre du pétrole, principe de toute croissance à l'occidentale.
Puis l'objectif véritable fut avoué : détruire la puissance de l'Irak, seul pays du Tiers-Monde possédant peut être les moyens de faire obstacle aux visées hégémoniques de l'Occident et d'Israël au Moyen -- Orient.
Il s'agissait d'une véritable guerre coloniale.
Le peuple irakien, par la guerre économique que lui livraient les émirs du Koweit (téléguidés par les Etats-Unis), était privé, avec 7 dollars de moins par baril de pétrole, de la moitié de son budget et voué à la faillite.
Mais la faiblesse politique de Sadam Hussein tombant à deux reprises (par l'invasion de l'Iran et pour l'opération au Koweit) dans le piége américain, a offert au complexe mllitaro- industriel le prétexte idéal pour une lntervention massive préparée depuis un tiers de siècle (depuis le projet de nationalisation des pétroles par Mossadegh en Iran)
Reçu par Saddam Hussein à Bagdad, le 5 décembre 1990 j'ai essayé, pendant deux heures d'entretien, en présence de deux de ses ministres et de deux généraux de son Etat-Major, de le convaincre de deux choses : d'abord qu'il n'y avait aucune symétrie entre lui et les Américains. A sa frontière il y a une armée, et, chez lui, un peuple. Peut-être peut-il faire quelque mal à cette armée (hypothèse qui ne s'est pas réalisée), mais cette armée peut faire beaucoup de mal à son peuple. J'en concluais qu'il devrait accepter de retirer du Koweit son armée, à condition qu'elle soit relevée par des contingents arabes de pays demeurés neutres, comme l'Algérie ou la Tunisie, afin de préparer un referendum de tous les habitants du Koweit (immigrés et autochtones). Il me rappela ses propositions du 12 août : l'Irak se retirera du Koweit si toutes les décisions des Nations-Unies sont appliquées (par exemple contre l'annexion de Jérusalem-Est, condamnée par toutes les nations, y compris par les Etats-Unis). Sa suggestion était parfaitement justifiée. Mais la méthode employée : l'occupation militaire, donnait un prétexte aux prétendus soldats de droit pour détruire un peuple.
Depuis la fin du Mandat britannique sur l'Irak (1930) les compagnies pétrolières occidentales (unies dans Irak petroleum) disposaient de 94 % du territoire Irakien. Lorsque la révolution irakienne du général Kassem décida de leur retirer ces concessions, la menace d'une intervention militaire anglaise, en 1961, imposa l'indépendance du Koweit, et son entrée aux Nations Unies en 1963.
L'émir du Koweit était dès lors chargé, par ses maîtres occidentaux, d'appliquer au pétrole (par exemple en inondant les marchés) la règle des échanges inégaux caractéristique du système colonial : faire baisser les prix des matières premières.
L'invasion du Golfe par les Etats-Unis et leurs vassaux, en 1990, renouvelle, à une échelle très supérieure, l'opération coloniale de 1961.
Les occidentaux appellent libération du Koweit le retour, dans les fourgons de l'armée américaine, de leurs prête-noms serviles et milliardaires. Le Koweit est, en effet, libéré de toute entrave à la spéculation financière la plus cynique, libéré de toute limite aux exactions de ses privilégiés corrompus. La ruée des grands rapaces coloniaux pour arracher des contrats et des parts de marché fait rage. Les entreprises américaines raflent, auprès des émirs revenus de leur Coblentz, la part du lion. Les autres se partagent les bas-morceaux en proportion des effectifs qu'ils ont engagés dans l'invasion, du rôle pris par les pétroliers et les multinationales dans le déploiement militaire qui a permis la restauration de leurs privilèges.
Comme tous les colonialismes, à travers les mensonges sur la guerre propre, chirurgicale, aseptisée, les américains ont livré à l'Irak une guerre totale avec les moyens techniques les plus sadiquement sophistiqués: une barbarie informatisée présentée comme un jeu électronique, avec des cibles dont on ne voit jamais les victimes déchiquetées. On ne comptabilise que les morts américains ou israéliens. Les autres ne comptent pas.
Comme autrefois le colonialisme espagnol réalisait le génocide des indiens d'Amérique par la supériorité technique de l'arme à feu, comme les colonialistes anglais utilisaient les armes automatiques pour massacrer au Soudan les hommes du Mahdi, comme Mussolini employait contre les éthiopiens les balles dum-dum destinées aux fauves, les américains expérimentent aujourd'hui les missiles guidés au laser, les bombes à dépression qui font éclater les poumons sur plusieurs kilomètres, et d'autres armes de destruction massive.
Le rapport entre le nombre de morts de l'armée coloniale et celui du pays envahi est toujours du même ordre de 1 pour mille, en raison de la supériorité technologique. Il en fut ainsi pour les Espagnols et les Indiens, pour les Anglais en Inde, pour les Américains au Viet-Nam, pour les Français en Afrique Noire et en Algérie.
Le commandement américain se vantait, lors du cessez le feu, le 28 février 1991, d'avoir déversé, en quarante jours, 100 000 tonnes d'explosifs sur l'Irak, c'est dire l'équivalent de plus de 4 Hiroshimas.
La tentative de maintenir par la force ce système post-colonial dans lequel l'Occident, avec un cinquième de la population mondiale, contrôle et consomme 80 % des ressources, et où sa croissance implique ainsi le sous-développement du reste du monde, conduirait à une véritable guerre de Cent ans entre le Nord et le Sud. Le Tiers Monde ne pouvant se laisser détruire et le monde riche se vouant à une crise sans issue en ruinant ses clients par la faillite et la famine. Les statistisques des Nations Unies nous apprennent que, dans le Tiers-Monde, par le jeu des échanges inégaux et de la dette, plus de 45 milllons d'êtres humains meurent chaque année de faim ou de malnutrition. L'ordre colonial et le droit qui le perpétue, imposent au Tiers Monde l'équivalent de quarante Auschwitz par an. La Crucifixion banalisée à l'échelle des multitudes.
Le dirigeant syndicaliste brésilien Lula écrit : "la troisième guerre mondiale est déjà commencée. Une guerre silencieuse mais qui n'en est pas moins sinistre.... Au lieu de soldats, ce sont des enfants qui meurent, au lieu de millions de blessés, des millions de chômeurs, au lieu de destruction de ponts, ce sont des fermetures d'usines, d'écoles, d'hopitaux.... C'est une guerre déclarée par les EtatsUnis contre le continent américain et tout le Tiers Monde."
La guerre du Golfe fut seulement une expression plus sauvage de cette guerre permanente.
Telle est l'ampleur de la défaite de l'homme masquée par le plus puissant lavage de cerveaux de millions d'hommes réalisé par le matraquage médiatique : l'on a présenté comme une victoire de la civilisation contre la barbarie l'instauration d'un ordre du monde où l'hégémonie militaire appartient à une societé qui porte tous les stigmates de la décadence.
Nous voici ramenés au temps de la décadence de la République romaine et de l'instauration d'un Empire romain, avec une polarisation croissante de la richesse et de la misère: Rome comptait alors 320 000 sans emplois. Les 6 plus grands propriétaires d'Afrique, au temps de Néron, possédaient la moitié des terres de cette province, comme aujourd'hui, aux Etats-Unis, 5 % des américains détiennent 90 % de la richesse nationale. Les légions faisaient peser leur joug de l'Atlantique à l'Asie.
Nous vivons une nouvelle fois une époque de pourrissement de l'histoire, caractérisée par la domination technique et militaire écrasante d'un empire qui n'est porteur d'aucun projet humain capable de donner un sens à la vie et à l'histoire.
Il fallut trois cents ans de révoltes larvaires, et surtout la formation de communautés autonomes d'un type nouveau échappant peu à peu aux tentacules de la pieuvre, pour que se crée un nouveau tissu social.
Cette naissance d'un monde humain, à partir de la préhistoire bestiale que nous continuons à vivre sous le signe de la barbarie informatisée, ne pourra naître que d'une prise de conscience, à l'échelle des peuples, de la malfaisance de ce monothéisme du marché et de ses sanglants prophètes.
Le fait que la manipulation médiatique et surtout la télévision puisse donner à 200 millions d'hommes (dont 30 millions vivent pourtant a un niveau infra-humain) la bonne conscience d'être ce qu'il y a de meilleur au monde, digne d'en être à la fois le modèle et le gendarme, sont les signes profonds de cette décadence qui s'exprime, au niveau individuel, par le crime.
Les statistiques de la police nous révèlent qu'à New-York toutes les 3 heures, une femme est violée, toutes les 2 heures un homme assassiné, toutes les 30 secondes un attentat commis. L'Amérique détient le record des suicides d'adolescents comme de la criminalité et compte 20 millions de drogués.
Tel est le mode de vie américain de nos moralistes au moment où Mr Bush organise des prières pour sa croisade du pétrole.
Ce mode de vie est celui de l'exaltation de l'argent et de la violence. Cette culture de l'inhumain est exportée dans le monde entier par les films américains. Ceux de la violence répressive des polars avec leurs cascades de coups de révolvers ; ceux de la violence raciste des westerns exaltant la chasse à l'indien ; ceux de la violence-spectacle des films d'épouvante.
Telle est la puissance qui détient l'empire du monde.
Aujourd'hui c'est le principe même du système : le monothéisme du marché (c'est à dire l'argent) comme seul régulateur de toutes les relations sociales (de l'économie à la politique et de l'art à la morale) qui est la plus grande défaite de l'homme.
Cette guerre coloniale et l'embargo assassin qui la perpétue, a servi de révélateur de la responsabilité des dirigeants et de la caducité des institutions, permettant ainsi de distinguer clairement ce que le Président Bush appelle : le nouvel ordre international (qui serait le maintien et le renforcement, dans le monde, du statu-quo colonial sous hégémonie américaine), d'un véritable nouvel ordre international qui en est le contraire.
Ce texte est extrait du livre de Roger Garaudy intitulé L'Avenir: mode d'emploi, divisé ici en sept parties. Il est édité en 1998 par les éditions Vent du Large et se trouve en librairie (ISBN: 2-912341-15-9). On peut s'adresser, au choix, à l'éditeur, 1 av. Alphand, 75116, Paris, à la Librairie de l'Orient, 18 rue des Fossés Saint Bernard, 75005, Tel.: 01 40 51 85 33, Fax: 01 40 46 06 46 ou à l'Association Roger Garaudy pour le dialogue des civilisations, 69 rue de Sucy, 94430 Chennevières sur Marne.Ce livre est affiché sur Internet à des fins d'étude, de recherche, sans but lucratif et pour un usage raisonnable. Pour nous, l'affichage électronique d'un document revient exactement à placer ce document sur les rayons d'une bibliothèque ouverte au public. Nous y avons mis du travail et un peu d'argent. Le seul bénéficiaire en est le lecteur de bonne foi, que nous supposons capable de juger par lui-même. Au lecteur intéressé, nous suggérons d'acheter le livre. Nous n'avons pas de raison de supposer que l'auteur de ce texte puisse être considéré comme responsable d'aucun autre texte publié sur ce site.
Roger Garaudy
L'AVENIR
MODE D'EMPLOI
Chapitres: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I -- D'où vient le danger de mort du XXIe siècle?
1) -- La planète est malade: un monde cassé
2) -- L'Occident est un accident: Il a cassé le monde par trois
3) -- Hitler a gagné la guerre.
-- La destruction de l'Union soviétique.
-- La vassalisation de l'Europe.
-- L'exclusion des races inférieures dans le monde.
II -- Comment construire l'unité humaine pour empêcher ce suicide planétaire
1) -- Par une mutation économique
2) -- Par une mutation politique
- Qu'est- ce qu'une démocratie? (Le monothéisme du marché détruit l'homme et sa liberté.)
-- D'une Déclaration des droits à une Déclaration des devoirs
-- La télévision contre la société3 -- Par une mutation de l'éducation
- qu'est-ce que l'éducation? (Lire des mots ou lire le monde?)
-- Mythologie ou histoire?
a -- La mystification de l'idée de nation.
c -- Le mythe et l'histoire en Israël
- Philosophie de l'être ou philosophie de l'acte?
4 -- Par une mutation de la foi
- ... Ce que les corrompus d'aujourd'hui appellent mes rêves.
I -- Trajectoire d'un siècle et d'une vie1 -- Avoir vécu un siècle en feu
2 -- Les rencontres sur le chemin d'en haut
3 -- 1968: Soyons raisonnables: demandons l'impossible
4 -- Philosophie de l'Etre et philosophie de l'Acte
II -- L'Occident est un accident (ses trois sécessions)
1re sécession: de Socrate à la Renaissance
2e sécession: les trois postulats de la mort:
a -- d'Adam Smith au monothéisme du marché. (De la philosophie anglaise.)
b -- de Descartes à l'ordinanthrope. (De la philosophie française)
c -- de Faust au monde du non-sens. (De la philosophie allemande)
a) -- Les Etats-Unis, avant-garde de la décadence
b) -- Les Etats-Unis, colonie d'Israël
III -- Une autre voie était possible
a) -- Les précurseurs: de Joachim de Flore au cardinal de Cues.
b) -- Les occasions manquées: de Thomas More à Montaigne.
IV -- L'avenir a déjà commencé
-- Le réveil de l'Asie: la nouvelle route de la soie.
-- Le réveil de l'Amérique Latine: la civilisation des tropiques.
English
Deutsch
Swedish